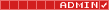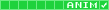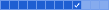En cette fin du mois d'août 2009, Nicolas Sarkozy ne décolère pas. La faute aux mauvais chiffres de la délinquance, à des statistiques revêches. Le président a donc convoqué à l'Elysée le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et ses principaux collaborateurs. Objectif: organiser la riposte à ces résultats insuffisants. Dans le huis clos du bureau présidentiel, le chef de l'Etat ne ménage pas son ami de presque trente ans. Avec lui, il peut s'épargner les précautions oratoires réservées à Michèle Alliot-Marie, le prédécesseur de "Brice". Un sursaut est exigé, et au plus vite. Stoïque, Hortefeux encaisse.
Le président le fait comprendre à plusieurs interlocuteurs: depuis son départ de la Place Beauvau, en 2007, ses successeurs dilapident l'"héritage". Son héritage. Ses deux passages en cinq ans à l'Intérieur (2002-2004, 2005-2007) l'ont marqué. Il a aimé la maison Police, il y a affiné sa stature présidentielle en se façonnant, de déclarations offensives en mesures ciblées, une image de champion de la sécurité. N'a-t-il pas fait fléchir la "courbe de la délinquance générale" de plus de 14 points depuis 2002? Et voilà que cet édifice -ce travail d'une vie ministérielle- lui semble soudain menacé. Depuis le début de 2009, la tendance repart à la hausse, tirée notamment par les cambriolages de résidences principales.
Après avoir stigmatisé l'incurie des socialistes en 2002, Nicolas Sarkozy s'en prend, cette fois, à l'apathie supposée des siens. Mais celui qui a théorisé le programme de l'UMP en matière de sécurité ne peut s'exonérer de ses propres échecs. Son bilan ne saurait se résumer à une courbe en apparence flatteuse, mais en trompe-l'oeil, de la délinquance générale... et à un art consommé du verbe. Sarkozy, le ministre, Sarkozy le candidat, ont su faire de la sécurité un thème porteur, en donnant l'illusion d'avoir ramené l'ordre.
Depuis le début de 2010, l'actualité sonne comme un douloureux rappel. Des agressions en milieu scolaire attisent le ras-le-bol des enseignants et trahissent une forme d'impuissance de l'Etat. Le meurtre d'une jeune mère, Tania, tuée par son ex-compagnon, le 16 février, en région parisienne ajoute au malaise. La victime s'était plainte des menaces de mort de cet homme jugé dangereux. Mais ni la police ni l'administration n'ont su l'aider. Les tendances lourdes sont tout aussi embarrassantes pour le Président: hausse des agressions contre les personnes, progression de la délinquance des mineurs, persistance du sentiment d'insécurité.
Comment expliquer ces difficultés? Pendant la période 2002-2010, Nicolas Sarkozy n'a pourtant pas lésiné sur les moyens. Intégration de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, renouvellement des équipements, nouvelle organisation à Paris et en banlieue, boom de la police technique et scientifique... Ce changement n'a pas encore porté ses fruits. Parallèlement, la majorité a accru les moyens répressifs. A l'instigation du ministre puis du président, une vingtaine de lois sur la sécurité ont été votées depuis 2002, au risque d'empiler des textes pas toujours applicables. Et de se voir reprocher des dispositions de circonstance, sur le thème "un fait divers, une loi". Sans résultats à court terme, là non plus.
Le pays est confronté en effet à une hausse irrépressible des "atteintes à l'intégrité physique" (vols avec violence, coups et blessures, menaces et chantages...). En douze mois, de février 2009 à janvier 2010, elles ont progressé de 2,6%. Ce phénomène, très français et très persistant, était certes perceptible depuis 1996, donc bien avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère, mais celui-ci n'a pas réussi à le juguler, malgré ses engagements répétés. En revanche, le nombre d'"atteintes aux biens" (vols, dégradations...) n'a jamais été aussi faible, même si cette performance positive ne relève pas seulement de l'action de la police : la meilleure sécurisation des véhicules et des domiciles contre les risques d'effraction ou de cambriolage y est pour beaucoup.
La hausse des agressions tranche avec la situation à l'étranger. Aux Etats-Unis, ce type de délinquance a baissé de 18,2% depuis 1996. En Allemagne, les agressions ont diminué pour la première fois en 2008, interrompant la hausse continue amorcée en 1996. En Angleterre et au pays de Galles, où la tendance est encore plus nette (-5,8% l'année passée), le taux d'agressions rapporté à la population reste cependant près de trois fois supérieur à celui de la France. "Nous assistons à une progression constante des violences physiques non crapuleuses, celles qui n'ont pas pour objet le vol, constate Christophe Soullez, de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Les services de police et de gendarmerie en comptabilisaient près de 240 000 l'année dernière. Une majorité d'entre elles sont commises dans la sphère familiale au cours d'incidents de la vie quotidienne, comme les différends entre les automobilistes et entre voisins."
Dans ce contexte défavorable, Brice Hortefeux ne pourra pas compter sur des renforts humains. Le ministre de l'Intérieur n'a pas été appuyé par son ami président: comme dans les autres secteurs de la fonction publique, la Révision générale des politiques publiques (RGPP), qui a pour but la diminution des dépenses de l'Etat, impose des restrictions d'effectifs.
La culture du résultat suscite de plus en plus de réserves
En 2010, police et gendarmerie perdront 2744 postes. La tendance se poursuivra au moins jusqu'en 2012. "Le redéploiement des forces a des limites. Remplacer les policiers par des caméras, comme c'est prévu, n'est pas satisfaisant; on a besoin de créer des liens avec la population", affirme Jean-Pierre Havrin, adjoint au maire de Toulouse (PS) et ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Intérieur.
Parmi les policiers et les gendarmes, la grogne gagne lentement du terrain. La culture du résultat, un moment compensée par les avantages matériels, suscite de plus en plus de réserves. "L'arrivée de Nicolas Sarkozy avait soulevé un grand espoir. Elle s'est traduite par une mobilisation sans précédent et des résultats. Mais, aujourd'hui, les policiers ne se sentent pas soutenus", confirme Sylvie Feucher, secrétaire générale du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN, majoritaire).
Le type de police et les consignes passées ces dernières années aux fonctionnaires ont un corollaire: l'explosion du nombre de gardes à vue, passé de 337 000 en 2001 à 580 000 en 2009 (+70%). Et encore, ce chiffre ne tient-il pas compte des infractions routières, non comptabilisées dans les statistiques de l'Intérieur. Lorsqu'il officiait Place Beauvau, Nicolas Sarkozy faisait des gardes à vue un indicateur phare de la performance des services. Dans son esprit, plus la police y avait recours, plus elle travaillait. Aujourd'hui, même le Premier ministre, François Fillon, dénonce cette inflation. D'autres voix plus inattendues se font entendre, comme celle de l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Et le président, d'ordinaire prolixe sur ces sujets, reste silencieux. En public, du moins.
L'alerte de 2009 marque également les limites du dogme de l'intervention, préféré à la police de proximité, raillée en son temps par l'ex-ministre de l'Intérieur. Le sociologue Sebastian Roché, spécialiste de ces questions, se montre très critique face aux options prises: "Les solutions conservatrices ont été privilégiées. Le choix s'est porté sur une police d'intervention. Celle-ci recourt à des moyens techniques (drones, hélicoptères, Flash-Ball...). Sur le terrain, les forces mobiles -CRS ou gendarmes- ou les services spécialisés dans l'action rapide sont de plus en plus utilisés. On a fait le choix de la police "qui arrive trop tard". Rappelons que c'est en France qu'ont eu lieu, en 2005, les émeutes urbaines les plus graves d'Europe." La doctrine a cependant évolué à la demande d'élus locaux, parfois issus de l'UMP, avec la création des Unités territoriales de quartier (Uteq). Leur extension est cependant gelée.