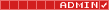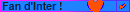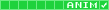Le principe de laÃŊcitÃĐ du service public est la composante principale de sa neutralitÃĐ. Aussi en est-il la plus connue, à la faveur des nombreux dÃĐbats et questionnements qui ont provoquÃĐ ou suivi lâapparition de rÃĻgles juridiques la renforçant. Cependant, si le concept semble frÃĐquemment utilisÃĐ, un rappel juridique de son encadrement ne semble pas superflu (A). Partant de cela, une rÃĐflexion sur la difficultÃĐ dâimposer des repas communautaires au sein des cantines scolaires pourra Être menÃĐe (B).
A) Les contours juridiques du concept de laÃŊcitÃĐ.
La prÃĐsente partie nâaura pas pour prÃĐtention de dÃĐcrire de façon exhaustive les textes et dÃĐcisions de justice qui imposent ce principe de laÃŊcitÃĐ du service public. De mÊme, il ne sâagira pas de rappeler lâhistorique de ce concept mais uniquement de reprendre les quelques ÃĐlÃĐments nÃĐcessaires à la suite de la rÃĐflexion.
Le premier des fondements de ce principe de laÃŊcitÃĐ se trouve à lâarticle premier de la Constitution. Cet article dispose en effet que ÂŦ la France est une RÃĐpublique indivisible, laÃŊque, dÃĐmocratique et sociale Âŧ. La prÃĐsence de cette mention dÃĻs le premier article de la norme suprÊme, toute symbolique soit-elle, montre bien lâimportance que le constituant a confÃĐrÃĐ Ã ce principe. Quoiquâil en soit, le Conseil Constitutionnel a rappelÃĐ Ã plusieurs reprises que le principe de laÃŊcitÃĐ prÃĐvu à lâarticle premier de la Constitution et son application au service public de lâenseignement, prÃĐvu par le treiziÃĻme alinÃĐa du PrÃĐambule de la Constitution de 1946, reprÃĐsentaient des ÂŦ rÃĻgles ou principes à valeurs constitutionnelles Âŧ[8]. DâaprÃĻs le Conseil, et selon la formule consacrÃĐe, le principe de neutralitÃĐ interdit que le service public soit assurÃĐ de façon diffÃĐrenciÃĐe en fonction des convictions politiques ou religieuses du personnel ou des usagers du service public.
Le Conseil dâÃtat a, quant à lui, suivi le mÊme mouvement en considÃĐrant, dans un arrÊt en date du 6 avril 2001, que le principe de laÃŊcitÃĐ figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la RÃĐpublique tels que les ont rÃĐaffirmÃĐs les prÃĐambules des constitutions des 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958[9]. Ce faisant, le Conseil dâÃtat a affirmÃĐ que les principes de laÃŊcitÃĐ et de neutralitÃĐ des services publics sâappliquent à lâensemble de ceux-ci[10]. Plus spÃĐcifiquement, la juridiction administrative suprÊme rappelle que, si les agents publics bÃĐnÃĐficient de la libertÃĐ de conscience interdisant toute discrimination religieuse à leur ÃĐgard en ce qui concerne lâaccÃĻs aux fonctions en cause ou le dÃĐroulement de leur carriÃĻre, le principe de neutralitÃĐ interdit à ces agents quâils manifestent leur croyance dans le cadre du service. Sâagissant des agents intervenant en milieu scolaire, le Conseil rappelle, dans le mÊme arrÊt, que cette prohibition sâapplique ÃĐgalement aux personnels nâintÃĐressant pas directement le service public dâenseignement. En consÃĐquences, une surveillante ou une personne en charge de la cantine se doit de respecter le principe de neutralitÃĐ religieuse, et ce, mÊme si elle ne participe pas directement au service public de lâenseignement.
Cette interdiction de faire valoir ses convictions religieuse a pris un tournent nouveau avec lâavÃĻnement des nouvelles technologies. Ainsi, le Conseil dâÃtat a-t-il considÃĐrÃĐ quâÃĐtait fondÃĐe la mesure sanctionnant un agent ayant fait usage de son adresse ÃĐlectronique professionnelle afin de publier un article sur le site dâune association religieuse. Le fait que lâagent se rÃĐclamait, sur ce site, de lâappartenance à cette communautÃĐ religieuse et publiait ses propos grÃĒce aux moyens technologiques fournis par et pour le service constituaient, pour les juges du Palais-Royal, un manquement au principe de laÃŊcitÃĐ et à lâobligation de neutralitÃĐ qui sâimpose à tout agent public.
Toutes ces dispositions qui ont trait au statut des agents publics montrent à quel point le principe de laÃŊcitÃĐ, est, dâune maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, trÃĻs inscrit dans la jurisprudence administrative. Ceci explique la grande difficultÃĐ Ã prendre en compte les impÃĐratifs religieux dans la mise en place des menus des cantines scolaires.
B) Des limitations juridiques aux repas communautaires.
On vient de voir que les rÃĻgles relatives à la laÃŊcitÃĐ sâappliquent avec vigueur aux agents en charge du service public. Plus largement, en imposant la stricte neutralitÃĐ Ã ses agents, lâAdministration cherche à protÃĐger les usagers de toute difficultÃĐ ayant trait à leurs pratiques religieuses. Ce nâest quâainsi que peut Être respectÃĐ le principe dâÃĐgal accÃĻs au service public. Les consÃĐquences de cette vision conduisent à la difficile mise en place de repas communautaires.
Lâune des premiÃĻres explications empÊchant la concoction de repas communautaires tient en la nature du service public de restauration scolaire. Le service de restauration scolaire est en effet vu comme un service annexe au service public de lâenseignement et nâest que facultatif. Ainsi, les enfants peuvent trÃĻs bien se passer dâun tel service de restauration en prenant leur repas ailleurs, notamment dans leur famille, ce qui rend impossible de voir, dans le refus de concocter des repas spÃĐciaux, une atteinte disproportionnÃĐe à la libertÃĐ de culte.
Le caractÃĻre facultatif de ce service fonde, dâailleurs, le fait quâaucun texte nâinterdit, nâoblige, ou ne permet explicitement, la mise en place de repas discriminatoires. Rien, en droit français ne fait donc ÂŦ obligation aux ÃĐtablissements scolaires de prendre en compte les pratiques religieuses des ÃĐlÃĻves, notamment en matiÃĻre alimentaire en proposant des plats de substitution dans les cantines scolaires [11]Âŧ. La justice administrative abonde ÃĐgalement dans ce sens[12]. Une telle obligation nâexiste que lorsque lâÃĐtat de santÃĐ dâun enfant nÃĐcessite la mise en place dâun repas spÃĐcifique adaptÃĐ Ã sa pathologie[13] (diabÃĻte, polyallergie, allergie à certaines substances comme le lactose ou lâarachide etc.). Cependant, dans ce cas, la diffÃĐrence est objective. Or, à dÃĐfaut de lâimposer[14], les principes du service public permettent la prise de dÃĐcisions discriminatoires si des conditions objectives le justifient[15]. Concernant les enfants atteints de pathologies, non seulement il existe un texte spÃĐcifique obligeant cette diffÃĐrence de traitement[16], mais en plus, ces ÃĐlÃĻves sont objectivement placÃĐs dans une situation diffÃĐrente. A contrario, la conviction religieuse nâest pas une situation qui justifie objectivement une telle diffÃĐrence de traitement en plus de ne pas pouvoir se fonder sur un texte lÃĐgislatif ou rÃĐglementaire.
Rappelons par ailleurs que les ÃĐlÃĻves frÃĐquentant les cantines scolaires sont placÃĐs dans une situation lÃĐgale et rÃĐglementaire en tant quâusager du service public de restauration collective. Or, en tant quâusager, ils nâont pas droit dâexiger le maintien des conditions de fonctionnement du service public. A fortiori, ils ne peuvent exiger une modification de la gestion de ce service dÃĻs lors que celui-ci fonctionne de façon ÂŦ normale Âŧ. Le Conseil Constitutionnel indiquait dâailleurs à ce propos que la Constitution, et le principe de laÃŊcitÃĐ quâelle renferme, ÂŦ interdisent à quiconque de se prÃĐvaloir de ses croyances religieuses pour sâaffranchir des rÃĻgles communes rÃĐgissant les relations entre collectivitÃĐs publiques et particuliers[17] Âŧ. Le Conseil dâÃtat abonde dans le mÊme sens en considÃĐrant que lâÃĐventuelle prise en compte des spÃĐcificitÃĐs religieuses des usagers ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause le fonctionnement normal du service public[18]. La circulaire du 16 aoÃŧt 2011, signÃĐe par lâactuel ministre de lâintÃĐrieur, rappelle dâailleurs ces prescriptions[19].
Enfin, il est, en pratique, trÃĻs courant que des communes prennent à leur charge une partie du ticket des repas servis au sein de leurs structures de restauration scolaire. Or, en instaurant un menu de type communautaire (halal pour reprendre les propos motivants cet article), une commune pourrait se voir assignÃĐe pour financement illÃĐgal dâun culte. En effet, lâarticle 2 de la loi de 1905 sur la sÃĐparation de lâÃĐglise et de lâÃtat dispose que ÂŦ La RÃĐpublique ne reconnaÃŪt, ne salarie ni ne subventionne aucun culte Âŧ. Or, nombre de subventions ont ÃĐtÃĐ dÃĐclarÃĐes illÃĐgales par le juge administratif sur le fondement de cette loi[20]. Il ne serait dÃĻs lors pas totalement impossible que, sur le mÊme fondement, une juridiction administrative sanctionne une commune qui aide au financement du ticket-repas si le repas proposÃĐ est trop explicitement liÃĐ Ã un culte.
On voit donc la difficultÃĐ qui existe à crÃĐer un repas ÂŦ discriminatoire Âŧ au sein dâun service local de restauration scolaire. Cependant, si le droit de la laÃŊcitÃĐ semble particuliÃĻrement restrictif, cette obligation lÃĐgale de neutralitÃĐ religieuse peut parfois se concilier avec la prise en compte des convictions personnelles de ses usagers.
II. Des dÃĐrogations possibles mais encadrÃĐes.
On a vu à quel point il semble difficile de prendre en compte les impÃĐratifs religieux dans lâÃĐlaboration des menus de cantines, notamment au regard du principe de neutralitÃĐ du service public. Cependant, si le principe de laÃŊcitÃĐ, qui en est lâun des dÃĐmembrements, apparaÃŪt comme une rÃĻgle restrictive, il ne faudrait pas en oublier le cÃītÃĐ protecteur, mÊme si celui-ci reste trÃĻs encadrÃĐ (A). Se fondant sur cette seconde qualitÃĐ, des menus spÃĐcifiques peuvent Être envisagÃĐs sans pour autant remettre en cause les grands principes du service public (B)
A) Une dimension protectrice du principe de laÃŊcitÃĐ restant encadrÃĐe
Le principe de laÃŊcitÃĐ est un ÂŦ principe Janus Âŧ. En effet, comme le dieu de la Rome antique, cette grande rÃĻgle, prÃĐvue par la Constitution, possÃĻde un double visage. Sâil a un caractÃĻre restrictif comme nous lâavons vu jusquâà prÃĐsent, ce principe a ÃĐgalement une facette protectrice des libertÃĐs fondamentales. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans le prolongement de sa jurisprudence traditionnelle en matiÃĻre de laÃŊcitÃĐ indique que ÂŦ la libertÃĐ de conscience doit [...] Être regardÃĐe comme lâun des principes fondamentaux reconnus par les lois de la RÃĐpublique[21] Âŧ.
Câest ainsi que lâimpÃĐratif de neutralitÃĐ du service public permet, justement, à tout agent du service public de bÃĐnÃĐficier dâune totale libertÃĐ de conscience et de culte dÃĻs lors quâil nâen fait pas ÃĐtat. Lâavis du 3 mai 2000 prÃĐ-citÃĐ prÃĐcise, en effet, que ÂŦ les agents du service de lâenseignement public bÃĐnÃĐficient comme tous les autres agents publics de la libertÃĐ de conscience qui interdit toute discrimination dans lâaccÃĻs aux fonctions comme dans le dÃĐroulement de la carriÃĻre qui serait fondÃĐe sur leur religion Âŧ. Concernant les usagers, la libertÃĐ de culte est, en soi, garantie par le neutralitÃĐ du service public ÃĐvoquÃĐe ci-dessus qui interdit à celui-ci de discriminer les usagers en fonction de leur religion ou de leurs opinions. Plus encore, le principe de laÃŊcitÃĐ tel que rÃĐgi par la Constitution permet aux administrÃĐs de sâexprimer publiquement à propos de leurs propres convictions religieuses.
NÃĐanmoins, la facette protectrice du principe de laÃŊcitÃĐ peut Être limitÃĐe pour des raisons dâordre public ou dâorganisation du service public. Dans ce cas, la libertÃĐ de culte doit Être conciliÃĐe avec les impÃĐratifs dâordre public en cause, le respect des libertÃĐs dâautrui, le pluralisme etc. La Cour europÃĐenne des droits de lâHomme, prenant en compte les spÃĐcificitÃĐs liÃĐes aux conceptions françaises et turques de la laÃŊcitÃĐ a dâailleurs ÃĐdictÃĐ une jurisprudence claire en la matiÃĻre. Comme il nâexiste pas de consensus au niveau europÃĐen ayant trait au principe de laÃŊcitÃĐ, la CEDH laisse une vÃĐritable marge dâapprÃĐciation aux Ãtats pour rÃĐglementer ce droit à la libertÃĐ dâexpression et à son application au culte. La CEDH vÃĐrifiera seulement que ÂŦ les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnÃĐes Âŧ en se fondant sur ÂŦ la protection des droits et libertÃĐs dâautrui, les impÃĐratifs de lâordre public, la nÃĐcessitÃĐ de maintenir la paix civile et un vÃĐritable pluralisme religieux Âŧ[22]. Confirmant sa jurisprudence, la CEDH en a dÃĐduit la lÃĐgitimitÃĐ et la proportionnalitÃĐ du dispositif français prohibant le port de signes religieux ostentatoires au sein des ÃĐcoles, collÃĻges et lycÃĐes publics [23].
Quoiquâil en soit, et outre le contrÃīle de lÃĐgitimitÃĐ et de proportionnalitÃĐ opÃĐrÃĐ par les juridictions tant nationales quâeuropÃĐennes, lâadministration doit veiller à ce quâen aucun cas une restriction à la libertÃĐ de culte ne soit fondÃĐe sur une discrimination niant les libertÃĐs fondamentales de tel ou tel groupe religieux. Câest ainsi, notamment, que lâadministration est fondÃĐe à interdire la distribution dâune soupe populaire confectionnÃĐe à base de porc en vue dâempÊcher sa distribution à des personnes de confession musulmane ou juive. En effet, dans un tel cas, lâatteinte à la dignitÃĐ de ces personnes ÃĐtant susceptible de remettre en cause lâordre public, il est permis à la prÃĐfecture dâinterdire le rassemblement[24]. Ce raisonnement a, par ailleurs, ÃĐtÃĐ validÃĐ par la Cour europÃĐenne des droits de lâHomme[25] qui a considÃĐrÃĐ, pour la mÊme affaire, que le prÃĐfet avait ÂŦ lÃĐgitimement considÃĐrÃĐ quâun rassemblement en vue de la distribution sur la voie publique dâaliments contenant du porc, vu son message clairement discriminatoire et attentatoire aux convictions des personnes privÃĐes du secours proposÃĐ, risquait de causer des troubles à lâordre public que seule son interdiction pouvait ÃĐviter Âŧ. Cette question a par ailleurs ÃĐtÃĐ mise à nouveau sur le devant de la scÃĻne dans le cadre de lâorganisation des ÂŦ apÃĐros saucissons-vin rouge Âŧ ; les prÃĐfectures ayant majoritairement interdit ce genre de rassemblements pour les mÊmes motifs.
On le voit donc, si la laÃŊcitÃĐ garantit la libertÃĐ de culte, dâexpression ou de rassemblement, elle ne peut tolÃĐrer lâinstitutionnalisation dâune quelconque forme de communautarisme. Dans ce cas, les autoritÃĐs administratives peuvent prendre toutes les mesures utiles nÃĐcessaires à la prÃĐservation de lâordre public, mais ÃĐgalement, de la diversitÃĐ religieuse. Ce faisant, il existe de vÃĐritables possibilitÃĐs permettant aux maires des communes concernÃĐes par un fort multiculturalisme, dâadapter les menus de cantines à cette diversitÃĐ.
B) La mise en place de menus adaptÃĐs aux spÃĐcificitÃĐs religieuses
Sans pour autant remettre en cause le principe de neutralitÃĐ du service public de restauration scolaire, un maire peut trÃĻs bien prendre en compte la spÃĐcificitÃĐ de sa population. Une conception pragmatique de la laÃŊcitÃĐ peut en effet conduire à la concoction de repas adaptÃĐs
Rappelons, avant tout, que si aucun texte nâoblige ou nâinterdit lâÃĐdition de menus adaptÃĐs, une une note de service en date du 21 dÃĐcembre 1982 prÃĐvoit la possibilitÃĐ de prendre en compte les ÂŦ habitudes et [les] coutumes alimentaires familiales, notamment pour les enfants dâorigine ÃĐtrangÃĻre Âŧ pour ÃĐdicter des menus[26]. Cependant, cette note de service reste une simple circulaire dÃĐpourvue de force obligatoire et ne peut, à ce titre, remettre en cause la neutralitÃĐ du service en cause.
On lâa vu, la crÃĐation de menus cachÃĻres, halals ou exclusivement catholiques nâest pas possible. Cependant, tout en respectant cette prohibition, un service de restauration scolaire peut trÃĻs bien, les jours oÃđ un aliment prohibÃĐ par lâune des religions est proposÃĐ Ã la consommation, proposer un plat alternatif. Ainsi, par exemple, si un repas à base de viande de porc est proposÃĐ, rien nâinterdit à la commune de proposer un plat alternatif qui nâen contient pas. Dans la mÊme vision, le respect du culte chrÃĐtien imposant la consommation de poisson le vendredi ne devrait pas, en principe, se faire au dÃĐtriment des autres ÃĐlÃĻves de confessions musulmanes ou israÃĐlites. Cependant, la jurisprudence est quelque peu hÃĐsitante sur cette question prÃĐcise. En effet, dans un arrÊt du 25 octobre 2002, le Conseil dâÃtat a considÃĐrÃĐ que les dispositions relatives aux menus prÃĐvoyant que ceux-ci ne comporteraient pas de viande le vendredi ÂŦ ne [faisant] rÃĐfÃĐrence à aucun interdit alimentaire ne [prÃĐsentaient] pas non plus un caractÃĻre discriminatoire en fonction de la religion des enfants ou de leurs parents[27] Âŧ. Cette dÃĐcision entretien lâambiguÃŊtÃĐ par rapport à la question de la neutralitÃĐ. Le Conseil dâÃtat explique, en effet, quâune telle disposition ne faisant pas expressÃĐment rÃĐfÃĐrence à un culte, elle ne pouvait Être annulÃĐe sur le fondement de la laÃŊcitÃĐ. Cependant, le caractÃĻre lapidaire de lâexplication ne convainc pas. La rÃĐfÃĐrence à un culte, si elle nâest pas explicite nâen nâest pas moins ÃĐvidente : le repas tel que prÃĐvu pour le vendredi vise à satisfaire les habitudes du cultes catholique. NÃĐanmoins, on ne peut que souscrire à la dÃĐcision du Conseil dâÃtat sur le fond, car, si lâabsence de viande au repas du vendredi privilÃĐgie le culte catholique, il nâempÊche pas les usagers se rÃĐclamant dâune autre religion de manger à la cantine ce jour.
Quoiquâil en soit, ce repas alternatif devra remplir sa mission de service public et Être ÃĐquilibrÃĐ ; ce qui impose que ce plat alternatif ait le mÊme apport de protÃĐines que le premier plat. Une telle alternative ne doit, en effet, pas se faire au dÃĐtriment nutritionnel de lâenfant et doit respecter lâensemble des rÃĻgles relatives à la qualitÃĐ nutritionnelle des repas servis au sein des cantines scolaires. Une telle alternative, telle quâadoptÃĐe par plusieurs communes, permet aux ÃĐlÃĻves de choisir et, surtout, nâimpose rien, puisque les plats de substitution ne seront pas ÂŦ rÃĐservÃĐs Âŧ à tel ou tel ÃĐlÃĻve. Chacun peut ainsi choisir le plat qui lui convient le mieux, en fonction de ses goÃŧts, de ses habitudes alimentaires ou de sa religion. Remarquons par ailleurs quâil serait illÃĐgal de mettre en place des tables rÃĐservÃĐes en fonction des plats choisis. Une telle discrimination risquerait à tout le moins de rompre le principe dâÃĐgalitÃĐ des usagers du service public et, au pire, dâinstitutionnaliser une discrimination fondÃĐe sur la religion.
Cependant, si une cette possibilitÃĐ est ouverte, il est indÃĐniable que la crÃĐation dâune telle alternative a des consÃĐquences sur la gestion du service de restauration scolaire et quâil faut bien considÃĐrer ces difficultÃĐs techniques, logistiques et financiÃĻres avant de prendre une telle dÃĐcision. Doivent par exemple Être pris en compte les coÃŧts supplÃĐmentaires ÃĐventuels et les difficultÃĐs dâorganisation qui pourront en dÃĐcouler (prospection du nombre de repas ; achats diffÃĐrenciÃĐs des aliments etc.)
Conclusion
Les principes de neutralitÃĐ du service public et de laÃŊcitÃĐ, sâimposent donc dans toute leur splendeur dans le cadre des cantines scolaires. Aussi, sâil est possible dâoffrir aux enfants des plats alternatifs pour prendre en compte le caractÃĻre multiculturel de certaines communes, il nâest pas possible de rompre lâÃĐgalitÃĐ des usagers en instaurant une discrimination alimentaire fondÃĐe sur lâappartenance religieuse de ces derniers. Il faut ÃĐgalement garder à lâesprit que de telles solutions alternatives risquent de peser sur les finances locales et sur lâorganisation du service public en rendant sa gestion plus ardue. NÃĐanmoins, lâanalyse des diffÃĐrents textes et leur application par les juridictions de notre pays permettent dâaffirmer que la proposition de repas ÂŦ marquÃĐs Âŧ religieusement ne saurait avoir cours dans nos cantines scolaires. Ainsi donc, la crainte du ministre de lâintÃĐrieur, qui est, rappelons-le, en charge des cultes, de voir de la viande halal dans les assiettes de nos enfants dans le cas oÃđ les ÃĐtrangers non-europÃĐens obtiennent le droit de vote et dâÃĐligibilitÃĐ aux ÃĐlections locales, nâest tout simplement pas fondÃĐe. Lâanalyse erronÃĐe faite par le ministre est nÃĐanmoins dâautant plus surprenante quâune circulaire en date du 16 avril 2011, signÃĐe de sa main, rappelle les grandes rÃĻgles juridiques et jurisprudentielles applicables en la matiÃĻre.