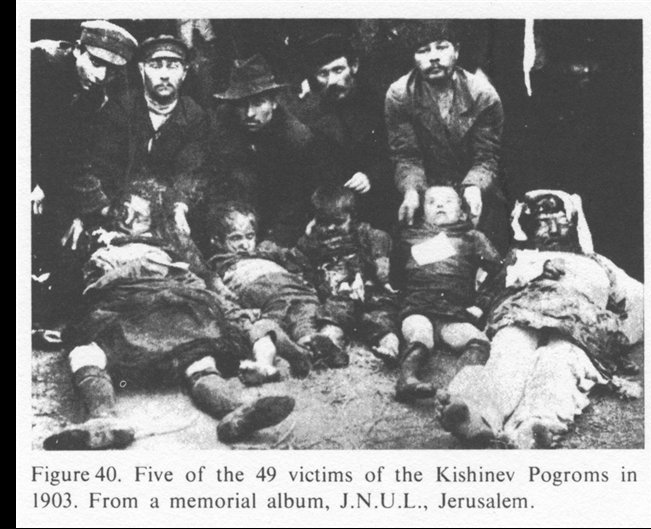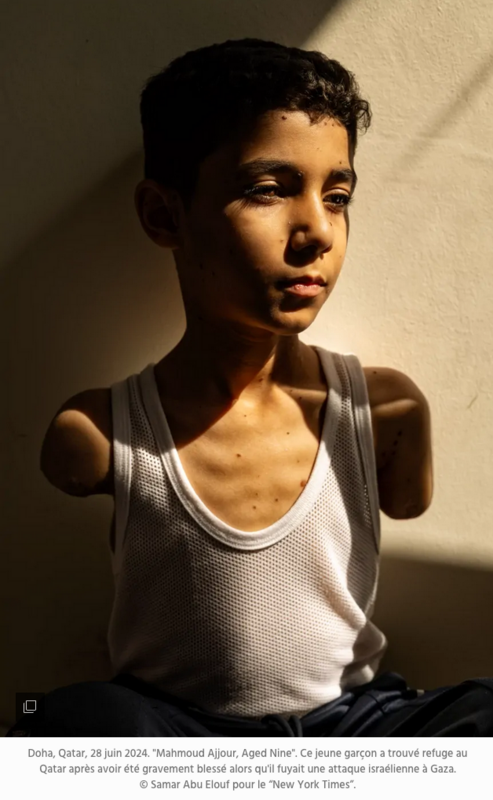Guerre à Gaza : ÂŦ Ãtre rÃĐserviste, pourquoi faire ? ÂŧâĶ En IsraÃŦl, le malaise grandit face à une guerre sans fin.
armÃĐeâĒDepuis prÃĻs de deux ans, la guerre à Gaza ÃĐpuise le systÃĻme des rÃĐservistes israÃĐliens, conçu pour des conflits brefs.
Fatigue, doutes et inÃĐgalitÃĐs fragilisent lâarmÃĐe
Le ministre de la DÃĐfense israÃĐlien, IsraÃŦl Katz, a donnÃĐ son feu vert, mercredi 20 aoÃŧt, au plan dâassaut sur la ville de Gaza. Il a simultanÃĐment ordonnÃĐ le rappel de 60 000 rÃĐservistes pour participer à lâopÃĐration, a annoncÃĐ son ministÃĻre. Le modÃĻle des rÃĐservistes, pilier du systÃĻme militaire, montre aujourdâhui ses limites. Les mÃĐdias israÃĐliens ÃĐvoquent des taux de recrutement en baisse, infÃĐrieurs à 80 % des objectifs des autoritÃĐs, selon Le Monde.
Dans ce contexte, prÃĻs de 1 000 rÃĐservistes de lâarmÃĐe de lâair, actifs et retraitÃĐs, ont publiÃĐ une lettre le 10 avril 2025 rÃĐclamant la libÃĐration des otages de Gaza, ÂŦ mÊme au prix dâune cessation immÃĐdiate des hostilitÃĐs Âŧ. LâarmÃĐe a rÃĐagi en renvoyant du service actif les signataires encore mobilisÃĐs, estimant quâils ne pouvaient pas utiliser la ÂŦ marque de lâarmÃĐe de lâair israÃĐlienne Âŧ pour contester des choix politiques.
Les rÃĐservistes signataires affirment ne pas appeler au refus de servir, mais demandent que la remise en libertÃĐ des otages prime sur la poursuite dâune guerre qui, selon eux, rÃĐpond dÃĐsormais à des ÂŦ intÃĐrÊts politiques et personnels Âŧ plutÃīt quâà la sÃĐcuritÃĐ nationale, rapporte Times of IsraÃŦl.
Un systÃĻme basÃĐ sur les rÃĐservistes
ÂŦ Le principe du systÃĻme israÃĐlien, ce sont les rÃĐservistes Âŧ, confirme Jean-Paul Chagnollaud, prÃĐsident de lâInstitut de recherche et dâÃĐtudes MÃĐditerranÃĐe Moyen-Orient. ÂŦ Un dispositif qui nâa de sens que dans le cadre de guerres brÃĻves Âŧ selon lui. Historiquement lâarmÃĐe a toujours fonctionnÃĐ sur ce modÃĻle : la guerre des Six Jours en 1967, ou encore celle du Kippour en 1973, avait durÃĐ quelques semaines.
Or, la guerre actuelle a franchi le cap des vingt-deux mois. Une situation inÃĐdite qui pÃĻse sur les rÃĐservistes, contraints de quitter famille et emploi pour des pÃĐriodes de plus en plus longues, et payant un lourd tribut à la guerre, puisque 40 % des soldats israÃĐliens tuÃĐs en opÃĐration sur le terrain à Gaza ÃĐtaient rÃĐservistes.
La perte de sens
ÂŦ
Beaucoup de gens disent : il faut arrÊter cette guerre. Ãtre rÃĐserviste, pourquoi faire ? Âŧ, rÃĐsume Jean-Paul Chagnollaud. Cette lassitude transparaÃŪt aussi dans les tÃĐmoignages. ÂŦ Certains rÃĐservistes sont en dÃĐsaccord avec ce quâils doivent faire Âŧ, note Jean-Paul Chagnollaud, en rÃĐfÃĐrence aux accusations de famine ou de transferts forcÃĐs de population.
Sur le micro de Radio France, Roni Zehavi, 66 ans, ancien combattant au Liban et rÃĐserviste depuis le 7 octobre 2023, raconte son refus de rejoindre son unitÃĐ aprÃĻs plus de 200 jours de service. ÂŦ Si vous prenez le risque de mourir pour votre pays, la question des raisons pour lesquelles vous agissez se pose. Jusque-là , jâai toujours rÃĐpondu à lâappel en respectant des valeurs que je dÃĐfendais. Mais partir à la guerre pour que le Premier ministre puisse conserver son siÃĻge, câest trÃĻs compliquÃĐ Âŧ, prÃĐcise-t-il.
Un appel ÂŦ Ã la fin de la guerre Âŧ
Les doutes ne se traduisent pas en refus massifs de servir, mais ils gagnent en lÃĐgitimitÃĐ. ÂŦ Vous avez, parmi les signataires des lettres de refus, des figures respectÃĐes de lâarmÃĐe et des services de renseignement. Cela apporte de la lÃĐgitimitÃĐ au mouvement et cela dit aussi combien cette position critique est partagÃĐe jusquâau plus haut niveau militaire Âŧ, analyse Yagil Levy, de lâInstitut dâÃĐtudes des relations civilo-militaires à lâOpen University dâIsraÃŦl, dans le Monde. ÂŦ Ils ne refusent pas de servir, ils appellent à la fin de la guerre Âŧ, souligne-t-il.
ÂŦ
Les rÃĐservistes veulent terminer la guerre aussi vite que possible, avoir des rÃĐponses sur comment les otages vont Être rendus et ÃĐliminer le Hamas Âŧ, rÃĐsume Dan*, un autre rÃĐserviste israÃĐlien. Vivant aux Ãtats-Unis, il se porte rÃĐguliÃĻrement volontaire pour servir son pays et a ÃĐtÃĐ enrÃīlÃĐ 3 fois depuis le dÃĐbut de la guerre.
Une mobilisation à deux niveaux
Pour lui, la mobilisation soulÃĻve un malaise ancien : celui des exemptions dont bÃĐnÃĐficient les ultra-orthodoxes, les Haredims. ÂŦ Ce nâest pas juste que certains soient exemptÃĐs alors que dâautres risquent leur vie. LâÃĐgalitÃĐ doit prÃĐvaloir : chacun doit contribuer à lâeffort collectif et recevoir en retour de lâÃtat. Âŧ, explique le jeune homme de 25 ans.
ÂŦ
Les exemptions dont bÃĐnÃĐficient les ultra-religieux, qui concernent entre 10 et 15 % de la population, nourrissent un malaise trÃĻs fort. Les partis religieux menacent de quitter la coalition si ces exemptions venaient à Être supprimÃĐes, et ce malgrÃĐ la dÃĐcision de la Cour suprÊme, en juin 2024, qui a jugÃĐ cette pratique illÃĐgale Âŧ, rappelle lâuniversitaire Jean-Paul Chagnollaud.
MalgrÃĐ cette contestation, Jean-Paul Chagnollaud rappelle que lâarmÃĐe israÃĐlienne reste une machine redoutablement efficace. Selon lui, les critiques actuelles expriment un malaise mais ne constituent pas un mouvement de dissidence.
Selon les autoritÃĐs, 59 otages, dont 24 seraient encore vivants, sont toujours retenus à Gaza dans des conditions extrÊmement difficiles.
https://www.20minutes.fr/monde/israel/4 ... guerre-fin