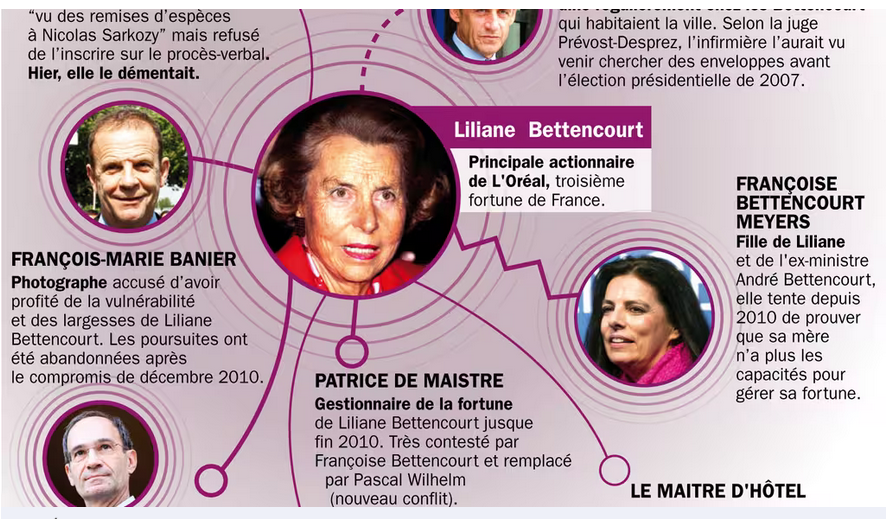Et oui...
Décryptage Condamnation de Nicolas Sarkozy : face aux attaques, les contre-vérités sur son jugement démystifiées
Peine «maximale», condamnation sans preuve ou justice politique… Décryptage des éléments de langage avancés par les éditorialistes et soutiens de l’ex-président pour décrédibiliser la décision des magistrats dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007.
Il fallait s’y attendre.
À peine le jugement du tribunal correctionnel de Paris avait-il été prononcé à l’encontre de Nicolas Sarkozy, jeudi 25 septembre, que contre-vérités et approximations envahissaient l’espace public et médiatique. L’ex-chef d’Etat a été condamné à cinq ans de prison ferme et passera par la case prison, une première.
Immédiatement, l’habituelle antienne contre l’institution judiciaire s’est élevée, ciblant ce «gouvernement des juges» qui n’aspirerait à rien d’autre qu’à se payer un ancien président.
Un refrain faisant fi des dix années d’instruction, des 73 tomes de procédure, des 54 perquisitions, des demandes d’entraide pénale internationale dans plus de 20 pays, et des trois mois de procès, durant lesquels les prévenus ont pu s’exprimer. «Une décision politique», a déclaré l’avocat de Sarkozy, Jean-Michel Darrois. «Une peine extrêmement sévère», a estimé le député UDR Eric Ciotti. «Un traitement exceptionnel, que rien ne justifie», selon le vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy. Libération décrypte ces fausses affirmations.
Condamné à la «peine maximale» ?
On a pu lire ou entendre, ici ou là, que Nicolas Sarkozy a été condamné à la peine «maximale».
Dans un tweet, effacé depuis, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, relayait cette idée, diffusée notamment par BFMTV.
C’est faux.
L’ex-président de la République a été reconnu coupable du délit d’association de malfaiteurs et condamné à cinq ans de prison. Or, Nicolas Sarkozy encourait davantage, car il «
s’est rendu coupable du délit d’association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Ce délit est, dès lors, lui-même puni de dix années d’emprisonnement», expliquent les juges dans leur décision.
Sur CNews, Laurence Ferrari questionne sur le ton de l’évidence : «Pourquoi avoir assorti une peine lourde, cinq ans, d’un mandat de dépôt si ce n’est pour l’humilier ?»
Parce que les faits sont d’une «exceptionnelle gravité» et «de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l’intérêt général, mais aussi dans les institutions mêmes de la République», avance le jugement.
Nicolas Sarkozy s’est rendu coupable d’un délit «contre la nation, l’Etat et la paix publique». Autant d’éléments qui rendent «nécessaire» un mandat de dépôt, aux yeux du tribunal.
En réalité, il est exceptionnel de ne pas être incarcéré sur-le-champ pour une telle peine. Ici, les juges ont différé le mandat de dépôt de Nicolas Sarkozy, car celui-ci «ne s’est jamais dérobé à la moindre convocation et a été présent à l’audience». Ils ont «tenu compte de la nécessité d’organiser sa vie professionnelle». A la différence de deux de ses coprévenus, l’ex-président a échappé à l’humiliation d’être menotté à la barre sous le regard de ses proches et des journalistes.
C’est pour «garantir l’effectivité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction» que les magistrats ont assorti ce mandat de dépôt d’une exécution provisoire.
Un mécanisme de droit qui suscite l’ire des politiques de droite et d’extrême droite, pourtant toujours prompts à réclamer un durcissement des peines.
«Le tribunal demande l’exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. La haine n’a aucune limite», s’est plaint Nicolas Sarkozy.
Selon les dernières statistiques de la chancellerie, 89 % des peines de 24 mois et plus sont exécutées immédiatement. Rien de plus banal, donc, que ce dispositif.
Une condamnation «sans preuve» ?
Plusieurs commentaires du jugement affirment que Nicolas Sarkozy aurait été condamné sans preuve, sur une seule intention et non une réalisation. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé l’ancien président de la République de trois des délits pour lesquels il était poursuivi : la corruption, le détournement de fonds publics et le financement illégal de campagne.
Nicolas Sarkozy est condamné pour l’infraction d’association de malfaiteurs. Ce délit réprime les projets délinquants et criminels. Il s’agit d’un «groupement formé» pour préparer un crime ou un délit. Cette infraction doit être caractérisée «par un ou plusieurs faits matériels», également appelés actes préparatoires. Il s’agit d’«un rassemblement de forces et de moyens ayant pour but de préparer l’exécution du délit, même si ce délit n’a pas été consommé, ni même tenté», explique le jugement.
Jeudi, à la sortie de la salle d’audience, Nicolas Sarkozy affirmait avoir été condamné pour avoir «prétendument laissé faire deux de [ses] collaborateurs [Claude Guéant et Brice Hortefeux, ndlr] qui auraient eu l’idée d’un financement illégal de [sa] campagne». D’autres, comme l’avocat Patrick Klugman, disent que l’ex-chef d’Etat a été «condamné sans preuve» ou encore, à l’image du commentateur Jean-Michel Aphatie, que «cette décision porte en elle quelque chose d’effrayant». Un refrain largement repris sur les plateaux télé dans les bouches d’éditorialistes ou de soutiens politiques.
La 32e chambre correctionnelle a pourtant bien retenu des preuves qui étayent les fameux actes préparatoires : elle ne condamne pas Nicolas Sarkozy sur la simple base d’un projet intellectuel ne s’étant jamais matérialisé. Les magistrats retiennent notamment comme «faits matériels», deux rencontres avérées de Guéant, puis Hortefeux avec Abdallah Senoussi, considéré comme le numéro deux du régime libyen, à l’époque, et visé par un mandat d’arrêt après sa condamnation à la perpétuité pour son rôle dans l’attentat du DC-10 d’UTA. Pour les magistrats, «les entretiens avec Abdallah Senoussi en marge des déplacements officiels ne peuvent qu’avoir un lien avec un pacte corruptif».
Le jugement retient également, comme actes préparatoires, les traces retrouvées par les enquêteurs de transferts de fonds libyens vers un compte contrôlé par l’intermédiaire Ziad Takieddine. De même que les notes manuscrites de l’ancien ministre du Pétrole libyen, Choukri Ghanem. Il s’agit pour les magistrats de «la mise à disposition par Ziad Takieddine de l’ingénierie financière nécessaire».
Les juges retiennent enfin un voyage de Nicolas Sarkozy en Libye où il a pu «rassurer Muammar Kadhafi sur sa volonté de continuer la politique de Jacques Chirac s’il était élu».
Rencontre au cours de laquelle «le dirigeant libyen a évoqué la situation de son beau-frère [Abdallah Senoussi]».
Pas «d’enrichissement personnel» ?
«Il n’y a pas de financement illégal de ma campagne, pas d’enrichissement personnel et la conclusion qu’en tire le tribunal, c’est que je dois passer cinq années en prison», a tonné jeudi Nicolas Sarkozy.
Il est bien exact que le tribunal correctionnel de Paris a indiqué qu’il n’existait pas de preuve d’un enrichissement personnel et a relaxé l’ancien président de la République du délit relatif au financement de sa campagne. Cependant, le fait qu’il n’y a pas de trace avérée de l’argent libyen dans les comptes du candidat en 2007 est indifférent, d’un point de vue pénal, pour l’infraction d’association de malfaiteurs pour laquelle il a été condamné.
https://www.liberation.fr/societe/polic ... MATKW3ICI/