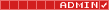On peut quand mÊme critiquer cette forme de fÃĐminisme superficiel.
Le premier rÃĐflexe dans ce genre de dÃĐbats est de sortir des fadaises du genre "le corps de la femme est beau, il faut l'exposer". Et toute critique est classÃĐe en pruderie.
Ce qui n'a rien à voir avec la plupart des critiques contre ces foires humaines.
Une fille à sa naissance va se voir imposer comme modÃĻles de rÃĐussitÃĐ, l'exploitation de sa beautÃĐ et plus tard sa vie de famille. C'est un carcan crÃĐÃĐ par d'innombrables sommations douces d'Être belle, agrÃĐable et se constituer comme beau parti d'une union future.
Le concours de Miss France à sa place au musÃĐe des obscenitÃĐs aux cÃītÃĐs des zoos humains de Vincennes.
Et ceux qui se pensent Être juste d'innocents esthÃĻtes n'ont strictement aucune perspective sur l'impact de ces foires sur la vision qu'ont les femmes d'elles mÊmes et le potentiel que cela gÃĒche.
Lisez ce passage de Mona Chollet:
Une couturiÃĻre venue de Haute-Savoie avec sa fille pour les demi-finales des Mini-Miss France 2011 à Paris explique à la reporter de Elle : ÂŦ Je suis seule avec ma fille, le papa est dÃĐcÃĐdÃĐ. Jamais je ne pourrai lui offrir une maison, elle devra se dÃĐbrouiller, alors je mets toutes les chances de son cÃītÃĐ. Âŧ Un pÃĻre, ouvrier en Bourgogne, ajoute : ÂŦ Savoir se prÃĐsenter, sourire, vaincre son trac, câest un plus pour quand elle passera un entretien dâembauche. Âŧ En attendant, il faut dÃĐbourser le prix des robes, du maquillage (quand mÊme utilisÃĐ), du trajet, des nuits dâhÃītel et du ticket dâentrÃĐe que les organisateurs font payer aux parents. En coulisses, les concurrentes ÂŦ comparent la longueur de leurs cheveux, la hauteur de leurs talons. Beaucoup se trouvent grassouillettes Âŧ. MÃĐlissandre, dix ans, confie : ÂŦ Tous les soirs, dans mon lit, je pense à la beautÃĐ. Jâaimerais me trouver belle, mais je nây arrive pas. Âŧ Une autre soupire : ÂŦ Moi, je veux arrÊter les Miss, je veux faire du cheval, mais ma mÃĻre ne veut pas. Âŧ
Si elle nâatteint pas toujours ces extrÊmes, lâÃĐducation des fillettes semble sâen tenir au mÊme ÃĐternel conformisme. Les parents jurent parfois avoir observÃĐ un goÃŧt ÂŦ spontanÃĐ Âŧ pour certains loisirs, en oubliant combien lâacquis peut facilement se travestir en innÃĐ, et en nÃĐgligeant les caractÃĐristiques propres à cet ÃĒge : le manque de recul et la recherche ÃĐperdue de conformitÃĐ, synonyme dâintÃĐgration et de popularitÃĐ auprÃĻs des petits camarades.
Tout cela exerce une influence directe sur les rÊves, les projets, les ambitions des adolescentes. Leurs fantasmes de succÃĻs se limitent souvent aux carriÃĻres qui feraient dâelles des objets de reprÃĐsentation : chanteuse, actrice, top model. Sara Ziff, ancien mannequin ayant repris des ÃĐtudes universitaires et auteure dâun documentaire sur son premier mÃĐtier, fait le mÊme constat : ÂŦ Dans les magazines pour adolescentes, les seules femmes qui sont mises en vedette, ce sont les mannequins et les actrices. ForcÃĐment, leurs lectrices en dÃĐduisent que câest cela, la rÃĐussite pour une femme. Âŧ Par ailleurs, cet accent mis sur leur apparence, à un ÃĒge oÃđ le rapport à leur corps est souvent difficile, les pousse à dÃĐvelopper une piÃĻtre estime dâelles-mÊmes à un moment oÃđ elles doivent faire des choix dâorientation dÃĐterminants, observe Catherine Monnot. La complexitÃĐ de lâidÃĐal fÃĐminin en circulation, qui implique de rÃĐussir sur tous les fronts et qui, pour leurs mÃĻres, se traduit par des emplois du temps infernaux, contribue encore à les inhiber. LâidÃĐe quâelles doivent chercher avant tout à plaire les amÃĻne à se tourner vers des mÃĐtiers ÂŦ qui leur permettront dâentrer en collaboration avec les autres, de leur venir en aide, et non pas de lutter contre euxÂŧ.
Les statistiques montrent les effets de ces reprÃĐsentations : elles rÃĐvÃĻlent, sur le marchÃĐ du travail, une double discrimination. Les femmes restent, dans leur majoritÃĐ, concentrÃĐes dans un petit nombre de domaines : en 2002, sur les trente et une catÃĐgories socioprofessionnelles que distingue lâInstitut national de la statistique et des ÃĐtudes ÃĐconomiques (Insee), les six catÃĐgories les plus fÃĐminisÃĐes regroupaient 60 % de lâemploi fÃĐminin (contre 52 % en 1983). Câest la discrimination ÂŦ horizontale Âŧ. Et, comme lâexplique Margaret Maruani, si certaines professions â mÃĐdecin, avocat, journaliste â ÂŦ se sont largement fÃĐminisÃĐes, sans pour autant se dÃĐvaloriser, le sommet de la hiÃĐrarchie rÃĐsiste à ce mouvement : câest la discrimination âverticaleâ Âŧ.