les envies des gueux lassentVictor a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 14:49Avec l'automatisation et la robotisation, j'espÃĻre bien que l'on pourra se dÃĐbarrasser de ces gueux.coincetabulle a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 07:58
et oui. les gueux doivent eux aussi s'acheter des habits, de l'ÃĐlectromÃĐnager, des chaussures et quelques autres bricoles. j'imagine qu'en cherchant bien tu y trouveras sans doute un cerveau pas chÃĻre. regarde du cotÃĐ du bon coin, un seconde main devrait largement te suffire.
Parce qu'en fait c'est cela le problÃĻme, tous ces gueux.
Sans tous ces gueux, on se retrouveraient entre gens biens, ÃĐduquÃĐs et aisÃĐs avec de bons revenus.
Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
-
lepicard
- Dieu D'Interaldys

- Messages : 22460
- EnregistrÃĐ le : 20 aoÃŧt 2017 21:14
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
-
papibilou
- Dieu D'Interaldys

- Messages : 20095
- EnregistrÃĐ le : 25 aoÃŧt 2020 20:42
- A Liké : 2 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
Vous vous lÃĒchez. Pas mal.lepicard a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 15:44les envies des gueux lassentVictor a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 14:49
Avec l'automatisation et la robotisation, j'espÃĻre bien que l'on pourra se dÃĐbarrasser de ces gueux.
Parce qu'en fait c'est cela le problÃĻme, tous ces gueux.
Sans tous ces gueux, on se retrouveraient entre gens biens, ÃĐduquÃĐs et aisÃĐs avec de bons revenus.

-
lepicard
- Dieu D'Interaldys

- Messages : 22460
- EnregistrÃĐ le : 20 aoÃŧt 2017 21:14
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
non , chez moi c'est naturel et pas toujours apprÃĐciÃĐ ,,,,, merci
- mic43121
- Rang Tisiphonesque

- Messages : 35622
- EnregistrÃĐ le : 23 mars 2016 19:42
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 2 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
TU es douÃĐ..
La tolÃĐrance c'est quand on connait des cons- et qu'on ne dit pas les noms
-
lepicard
- Dieu D'Interaldys

- Messages : 22460
- EnregistrÃĐ le : 20 aoÃŧt 2017 21:14
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
je sais ,, mais je n'aime pas qu'on me le dise
par contre , j'avais soulevÃĐ la question d'encadrement des marges ,,,,, c'est trop compliquÃĐ ???? ou c'est gÃĐnant ?????
- Fonck1
- Administrateur
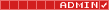
- Messages : 151299
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 7 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
Je suis dÃĐsolÃĐ de te lâapprendre, mais les gueux seront toujours là , ce qui nâest pas le cas de tous tes potes cadres et chefs dâentreprise, lâIA arrive à grands pas, et elle va defoncer tous les grattes papiers surpayÃĐs et sur-diplÃīmÃĐs à rien foutre.Victor a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 14:49Avec l'automatisation et la robotisation, j'espÃĻre bien que l'on pourra se dÃĐbarrasser de ces gueux.coincetabulle a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 07:58
et oui. les gueux doivent eux aussi s'acheter des habits, de l'ÃĐlectromÃĐnager, des chaussures et quelques autres bricoles. j'imagine qu'en cherchant bien tu y trouveras sans doute un cerveau pas chÃĻre. regarde du cotÃĐ du bon coin, un seconde main devrait largement te suffire.
Parce qu'en fait c'est cela le problÃĻme, tous ces gueux.
Sans tous ces gueux, on se retrouveraient entre gens biens, ÃĐduquÃĐs et aisÃĐs avec de bons revenus.
"Le fascisme ça commence avec les fous, ça se rÃĐalise grÃĒce aux salauds et ça continue à cause des cons."
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)
-
vivarais
- Rang Tisiphonesque

- Messages : 47514
- EnregistrÃĐ le : 04 avril 2018 16:39
- A été liké : 1 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
Victor est aussi un gueux aux yeux de la caste dominante mais il 'n'en est pas conscientFonck1 a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 01:42Je suis dÃĐsolÃĐ de te lâapprendre, mais les gueux seront toujours là , ce qui nâest pas le cas de tous tes potes cadres et chefs dâentreprise, lâIA arrive à grands pas, et elle va defoncer tous les grattes papiers surpayÃĐs et sur-diplÃīmÃĐs à rien foutre.Victor a ÃĐcrit : 10 juillet 2024 14:49
Avec l'automatisation et la robotisation, j'espÃĻre bien que l'on pourra se dÃĐbarrasser de ces gueux.
Parce qu'en fait c'est cela le problÃĻme, tous ces gueux.
Sans tous ces gueux, on se retrouveraient entre gens biens, ÃĐduquÃĐs et aisÃĐs avec de bons revenus.
tout individu qui n'a pas ses revenus en dormant mais par son travail est un gueux
la robotique exclut certains du monde travail
demain c'est l'IA qui en excluera d'autres
c'est comme les plans sociaux d'abord çà commence par le premier ÃĐchelon puis çà se termine une fois la dÃĐlocalisation rÃĐalisÃĐe par le dernier "la direction"
alors celui qui pense que les gueux c'est les autres
-
UBUROI
- Dieu D'Interaldys

- Messages : 21202
- EnregistrÃĐ le : 19 fÃĐvrier 2017 21:40
- A Liké : 4 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
Les "gueux"...et comme dit l'autre "le gros des gueux lasse" surtout quand ces ensÃĐphalogrammes plats votent RN!, ce sont sans doute en partie ceux visÃĐs par une excellente tribune parue dans Le MOnde, l'une de mes bibles.vivarais a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 03:35Victor est aussi un gueux aux yeux de la caste dominante mais il 'n'en est pas conscientFonck1 a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 01:42
Je suis dÃĐsolÃĐ de te lâapprendre, mais les gueux seront toujours là , ce qui nâest pas le cas de tous tes potes cadres et chefs dâentreprise, lâIA arrive à grands pas, et elle va defoncer tous les grattes papiers surpayÃĐs et sur-diplÃīmÃĐs à rien foutre.
tout individu qui n'a pas ses revenus en dormant mais par son travail est un gueux
la robotique exclut certains du monde travail
demain c'est l'IA qui en excluera d'autres
c'est comme les plans sociaux d'abord çà commence par le premier ÃĐchelon puis çà se termine une fois la dÃĐlocalisation rÃĐalisÃĐe par le dernier "la direction"
alors celui qui pense que les gueux c'est les autres
C'est un philosophe qui l'ÃĐcrit, Jean Yves ParenchÃĻre
Je vous la livre gratuitement et vous pourrez mÃĐditer sur l'emprise du RN sur la populace du nord et du sud est, terres d'ÃĐlection de ce parti viral. Si vous Êtes sensible à la dÃĐmonstration du prof à l'UniversitÃĐ Libre de Bruxelles, vous y verrez une photographie...radiographie du gueux franchouillard, rÃĐcupÃĐrÃĐ par les populistes de Montretout, la maison mÃĻre du RN.Dans une tribune au ÂŦ Monde Âŧ, le professeur de thÃĐorie politique estime que le parti rÃĐduit la sociÃĐtÃĐ Ã un marchÃĐ. Ses ÃĐlecteurs demandent à disposer des moyens de consommer, mais aussi à Être ÂŦ chez eux Âŧ dans un espace qui serait le leur, excluant les ÂŦ ÃĐtrangers Âŧ aussi bien que des contraintes ÃĐcologiques
PubliÃĐ hier à 16h00, modifiÃĐ hier à 20h29
IntÃĐressant et inquiÃĐtant de voir que des annÃĐes 80 à maintenant, notre sociÃĐtÃĐ protectrice à l'outrance (dÃĐpenses sociales les + ÃĐlevÃĐes en UE), notre systÃĻme ÃĐducatif en ÃĐchec et l'entreprise qui exclut le travailleur de sa gestion (systÃĻme allemand) ont transformÃĐ des citoyens en "gueux" (dont les gilets jaunes)https://www.lemonde.fr/idees/article/20 ... _3232.html
Les rÃĐsultats du second tour des ÃĐlections lÃĐgislatives, dimanche 7 juillet, nous ont accordÃĐ un sursis inespÃĐrÃĐ, mais le pire reste possible à lâhorizon de 2027. Non seulement la facture monarchique de la Ve RÃĐpublique, redoublÃĐe par la verticalitÃĐ macroniste, a multipliÃĐ les frustrations qui nourrissent les tentations autoritaires, non seulement la tripartition politique de lâÃĐlectorat rend le scrutin majoritaire dangereusement dysfonctionnel, mais notre Constitution nous donne peu de protections durables contre une ÃĐventuelle mainmise de lâextrÊme droite sur lâEtat.
Quant à la culture politique dominante, elle est colonisÃĐe par des rhÃĐtoriques qui configurent ce que la journaliste Isabelle Kersimon appelle Les Mots de la haine (Rue de Seine, 2023), une ÂŦ alt-rÃĐalitÃĐ Âŧ, thÃĐÃĒtre dâombres oÃđ le ÂŦ wokisme Âŧ, le fÃĐminisme et la lutte contre les discriminations passent pour des dangers plus grands que le racisme ou lâinfÃĐodation au fascisme poutinien.
LâextrÊme droite diffuse ses thÃĻmes jusque dans des milieux supposÃĐs centristes : certains ont mis en ÃĐquivalence lâunion des gauches, commandÃĐe par lâurgence, et un parti souhaitant ÃĐtouffer progressivement lâEtat de droit ; dâautres ont appelÃĐ de facto à voter Rassemblement national (RN) pour ÂŦ faire barrage Âŧ à la gauche. Ils nâont heureusement pas ÃĐtÃĐ suivis, mais il reste que les scores des candidats de la gauche, du centre et de la droite libÃĐrale ont ÃĐtÃĐ dus à  un front rÃĐpublicain traversÃĐ de fragilitÃĐs et non à une adhÃĐsion programmatique.
Lire aussi lâenquÊte | Article rÃĐservÃĐ Ã nos abonnÃĐs Comment les idÃĐes dâextrÊme droite se sont banalisÃĐes dans le monde intellectuel français
Nous ne sommes pas dans les annÃĐes 1930 : nous ne vivons pas dans une sociÃĐtÃĐ brutalisÃĐe par une guerre rÃĐcente ; lâeffritement de lâEtat social ne peut pas se comparer aux dÃĐvastations dâune crise ÃĐconomique gÃĐante ; les masses ne sont pas mobilisÃĐes dans des partis militarisÃĐs. Mais une passivitÃĐ mÃĐcontente, ÃĐloignÃĐe de tout dÃĐsir sacrificiel, souhaite quâun chef la dÃĐbarrasse magiquement de la complexitÃĐ du rÃĐel : le RN propose de faire comme si la crise climatique nâexistait pas. Seule compte la haine dâune ÂŦ immigration Âŧ non dÃĐfinie, oÃđ lâon inclut sans le dire les Français qui ne sont pas Blancs, et la dÃĐfense dâune ÂŦ identitÃĐ Âŧ tout aussi indÃĐfinie, susceptible de fonctionner comme une arme arbitraire contre nâimporte quel citoyen français, de nâimporte quelle origine. Le reste du programme du RN semble nâimporter ni à ses ÃĐlecteurs ni à ses dirigeants, qui ne cessent de renier leurs promesses prÃĐtendument ÂŦ sociales Âŧ.
Avatar de la pensÃĐe nÃĐolibÃĐrale
Le RN puisse sa force dans la façon dont il conjoint une intention discriminatoire sans ambiguÃŊtÃĐ (contre les binationaux, les ÂŦ immigrÃĐs Âŧ, les ÂŦ Français de papier Âŧ, les ÂŦ assistÃĐs Âŧ) et, dâautre part, une pratique de lâÃĐquivoque, du mensonge et de lâincohÃĐrence qui, loin de lui nuire, lui permettent dâÊtre un agrÃĐgateur de haines hÃĐtÃĐrogÃĻnes et de publics dont les demandes ÃĐconomiques et sociales sont incompatibles entre elles. Au Royaume-Uni, le vote pour le Brexit sâÃĐtait cristallisÃĐ autour dâun slogan dâautant plus attractif quâil nâavait aucun sens prÃĐcis : ÂŦ Reprendre le contrÃīle Âŧ.
Le vote pour le RN semble guidÃĐ par le dÃĐsir ÂŦ dâÊtre chez soi Âŧ. Ce ÂŦ chez soi Âŧ est un signifiant vide : personne ne lui donne le mÊme contenu ; mais son indÃĐfinition permet à des publics dont les peurs sont trÃĻs diffÃĐrentes de communier dans un mÊme fantasme par lequel ils se sentent ÂŦ exprimÃĐs Âŧ. La revendication de la ÂŦ souverainetÃĐ Âŧ sert alors de masque à un projet tournÃĐ contre la dÃĐmocratie, câest-à -dire contre lâÃĐgalitÃĐ des droits et le partage dâun mÊme espace politique et social de coopÃĐration et de dÃĐlibÃĐration.
Seule la sociologie empirique peut nous informer sur les ressorts de lâadhÃĐsion ÃĐlectorale à  lâillibÃĐralisme. On peut cependant se demander si le dÃĐsir dâÊtre ÂŦ chez soi Âŧ et le ÂŦ souverainisme Âŧ qui lâaccompagne ne sont pas la traduction normale du type social quâont promu les politiques ayant dominÃĐ les derniÃĻres dÃĐcennies : le type du ÂŦ consommateur souverain Âŧ, dont la souverainetÃĐ sâexerce dans le pouvoir de consommer.
Lire aussi | Article rÃĐservÃĐ Ã nos abonnÃĐs Comment les thÃĻmes favoris du RN ont peu à peu colonisÃĐ les mÃĐdias traditionnels
On sait, grÃĒce à lâhistorien suÃĐdois Niklas Olsen, que toute une lignÃĐe de penseurs et de politiques ÂŦ nÃĐolibÃĐraux Âŧ a formulÃĐ le double projet dâune rÃĐduction de la sociÃĐtÃĐ Ã un marchÃĐ et de la dÃĐmocratie à la souverainetÃĐ du consommateur (The Sovereign Consumer, Niklas Olsen, Palgrave Macmillan, 2019).
Le vote RN pourrait bien Être un effet de la rÃĐalisation de ce projet : les ÂŦ consommateurs souverains Âŧ, en votant contre la dÃĐmocratie, affirment leur fureur de ne pas Être rÃĐellement souverains en tant que consommateurs ; ils demandent à disposer des moyens de consommer, mais aussi à Être ÂŦ chez eux Âŧ dans un espace qui serait le leur, et non un espace commun obligeant aux compromis dâune sociÃĐtÃĐ pluraliste et ÃĐgalitaire. HabitÃĐs par la peur du dÃĐclassement et un sentiment de relÃĐgation, ces ÃĐlecteurs aspirent à un vain repli sur les frontiÃĻres nationales.
Les droits des autres comme nuisances
Le ÂŦ consommateur Âŧ nâest plus ici celui qui exerce un choix sur un marchÃĐ, mais celui qui veut affirmer sa souverainetÃĐ en refusant que son espace social soit autre chose quâun espace rÃĐservÃĐ aux objets de ses choix, excluant la prÃĐsence importune des ÂŦ ÃĐtrangers Âŧ aussi bien que des contraintes ÃĐcologiques.
Le vote pour le RN, câest la rÃĐvolte des consommateurs souverains. De là ce paradoxe dâune extrÊme droite dont lâextrÃĐmisme nâest plus celui des fanatismes fascistes, mais de ceux qui ont la nostalgie dâune France imaginaire (qui aurait existÃĐ dans les annÃĐes 1960) et qui ne veulent pas Être dÃĐrangÃĐs par les droits des autres.
Lire aussi | Article rÃĐservÃĐ Ã nos abonnÃĐs ÂŦÂ Essayer le RNÂ ÂŧÂ : sur les ÃĐcrans, lâavÃĻnement du citoyen-consommateur
On ne rÃĐpondra pas à cette fureur, qui croit compenser son impuissance politique par la violence sociale et par lâaffirmation de la supÃĐrioritÃĐ imaginaire dâune ÂŦ identitÃĐ Âŧ, en accÃĐdant à ses demandes de discrimination. On ne lui rÃĐpondra pas non plus en donnant une version de gauche des rhÃĐtoriques ÂŦ antisystÃĻme Âŧ. On ne pourra lui rÃĐpondre que par la proposition dâune nouvelle puissance politique, qui devra Être dâÃĐchelle europÃĐenne, et par une reprise de la question sociale. Celle-ci ne peut pas Être rabattue sur un programme de dÃĐpenses publiques ou dâadministration ÃĐtatiste des nÃĐcessaires protections sociales. Son enjeu est celui de la dÃĐmocratie sociale, de lâintÃĐgration de tous au sein du tissu coopÃĐratif dâune socialitÃĐ et dâune socialisation dÃĐmocratiques.
Bonne soupe!
'Ubu XIV rÃĐgna de 800 av.jt à l'an 2035, date prÃĐsumÃĐe de la fin du monde, sur le peuple des Provocs en lutte contre les envahisseurs Bollogoths, peuplade barbare d'extrÊme droite convertie au cathodicisme intÃĐgral par Vincent de Ker Meinkampf.
- mic43121
- Rang Tisiphonesque

- Messages : 35622
- EnregistrÃĐ le : 23 mars 2016 19:42
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 2 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
Tu parles d'une soupe .. 
C'est truffÃĐ de mensonges ..
C'est mÃĐconnaitre et discriminer .
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
C'est truffÃĐ de mensonges ..
C'est mÃĐconnaitre et discriminer .
La tolÃĐrance c'est quand on connait des cons- et qu'on ne dit pas les noms
-
Once
- Posteur Titanesque

- Messages : 9469
- EnregistrÃĐ le : 02 novembre 2020 08:46
- A Liké : 1 fois
- A été liké : 7 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
Je lis assez souvent Le Monde moi aussi. Non pas comme un fan enthousiaste mais autant que possible avec un esprit critique qui apprÃĐcie parfois mais qui rÃĐprouve aussi parfois.
J'ai lu rÃĐcemment deux grandes pages sur la "derniÃĻre journÃĐe de Nahel." Un long, un trÃĻs long article/ roman bourrÃĐ d'idÃĐologie misÃĐrabiliste qui montre à quel point ce quotidien vit parfois dans un monde à part et semble Être coupÃĐ du rÃĐel.
Parce que si-face à cet article- Le Monde aurait eu la bonne idÃĐe de pondre deux grandes mÊme pages sur la "derniÃĻre journÃĐe du policier" qui a tirÃĐ sur Nahel, là , au moins, j'aurais dit : "chapeau, ça c'est du journalisme !"
J'ai lu rÃĐcemment deux grandes pages sur la "derniÃĻre journÃĐe de Nahel." Un long, un trÃĻs long article/ roman bourrÃĐ d'idÃĐologie misÃĐrabiliste qui montre à quel point ce quotidien vit parfois dans un monde à part et semble Être coupÃĐ du rÃĐel.
Parce que si-face à cet article- Le Monde aurait eu la bonne idÃĐe de pondre deux grandes mÊme pages sur la "derniÃĻre journÃĐe du policier" qui a tirÃĐ sur Nahel, là , au moins, j'aurais dit : "chapeau, ça c'est du journalisme !"
-
UBUROI
- Dieu D'Interaldys

- Messages : 21202
- EnregistrÃĐ le : 19 fÃĐvrier 2017 21:40
- A Liké : 4 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
HS innommable!!Once a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 08:25 Je lis assez souvent Le Monde moi aussi. Non pas comme un fan enthousiaste mais autant que possible avec un esprit critique qui apprÃĐcie parfois mais qui rÃĐprouve aussi parfois.
J'ai lu rÃĐcemment deux grandes pages sur la "derniÃĻre journÃĐe de Nahel." Un long, un trÃĻs long article/ roman bourrÃĐ d'idÃĐologie misÃĐrabiliste qui montre à quel point ce quotidien vit parfois dans un monde à part et semble Être coupÃĐ du rÃĐel.
Parce que si-face à cet article- Le Monde aurait eu la bonne idÃĐe de pondre deux grandes mÊme pages sur la "derniÃĻre journÃĐe du policier" qui a tirÃĐ sur Nahel, là , au moins, j'aurais dit : "chapeau, ça c'est du journalisme !"
C'est une tribune cet article.
Que penses tu de la thÃĐorie de ce prof?
Moi, je partage assez cette vision du troupeau qui vote RN: " du Nutella et du On est chez nous" vocifÃĐrÃĐ par les inondÃĐs du nord qui s'en prennent aux verts comme par les petits patrons du sud est ciottiste!
'Ubu XIV rÃĐgna de 800 av.jt à l'an 2035, date prÃĐsumÃĐe de la fin du monde, sur le peuple des Provocs en lutte contre les envahisseurs Bollogoths, peuplade barbare d'extrÊme droite convertie au cathodicisme intÃĐgral par Vincent de Ker Meinkampf.
- Fonck1
- Administrateur
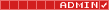
- Messages : 151299
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 7 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
c'est une tribune de philosophe, faut se dÃĐtendre.
"Le fascisme ça commence avec les fous, ça se rÃĐalise grÃĒce aux salauds et ça continue à cause des cons."
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)
-
Once
- Posteur Titanesque

- Messages : 9469
- EnregistrÃĐ le : 02 novembre 2020 08:46
- A Liké : 1 fois
- A été liké : 7 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
C'est bien plus compliquÃĐ que tout ça à mon avis. Il n'y a pas que cet ÃĐlectorat là qui se sent frustrÃĐ (mÊme si ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons). Il y en a d'autres. Par exemple, je ne mettrais pas (tous) les GJ dans le mÊme panier.UBUROI a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 08:38HS innommable!!Once a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 08:25 Je lis assez souvent Le Monde moi aussi. Non pas comme un fan enthousiaste mais autant que possible avec un esprit critique qui apprÃĐcie parfois mais qui rÃĐprouve aussi parfois.
J'ai lu rÃĐcemment deux grandes pages sur la "derniÃĻre journÃĐe de Nahel." Un long, un trÃĻs long article/ roman bourrÃĐ d'idÃĐologie misÃĐrabiliste qui montre à quel point ce quotidien vit parfois dans un monde à part et semble Être coupÃĐ du rÃĐel.
Parce que si-face à cet article- Le Monde aurait eu la bonne idÃĐe de pondre deux grandes mÊme pages sur la "derniÃĻre journÃĐe du policier" qui a tirÃĐ sur Nahel, là , au moins, j'aurais dit : "chapeau, ça c'est du journalisme !"
C'est une tribune cet article.
Que penses tu de la thÃĐorie de ce prof?
Moi, je partage assez cette vision du troupeau qui vote RN: " du Nutella et du On est chez nous" vocifÃĐrÃĐ par les inondÃĐs du nord qui s'en prennent aux verts comme par les petits patrons du sud est ciottiste!
Le problÃĻme ÃĐtant que, depuis sa tour, Macron fait tout pour opposer les diffÃĐrentes catÃĐgories de frustrÃĐs entre elles. Mais tous les dirigeants font cela : c'est le fameux "diviser pour mieux rÃĐgner".
Edit : les tribunes publiÃĐes dans Le Monde n'y sont pas publiÃĐes par hasard. Elles sont le fruit de lignes ÃĐditoriales choisies et parfaitement assumÃĐes sur le plan idÃĐologique.
-
vivarais
- Rang Tisiphonesque

- Messages : 47514
- EnregistrÃĐ le : 04 avril 2018 16:39
- A été liké : 1 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
vos incantations ne changent rien à l'ÃĐvidenceUBUROI a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 08:38HS innommable!!Once a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 08:25 Je lis assez souvent Le Monde moi aussi. Non pas comme un fan enthousiaste mais autant que possible avec un esprit critique qui apprÃĐcie parfois mais qui rÃĐprouve aussi parfois.
J'ai lu rÃĐcemment deux grandes pages sur la "derniÃĻre journÃĐe de Nahel." Un long, un trÃĻs long article/ roman bourrÃĐ d'idÃĐologie misÃĐrabiliste qui montre à quel point ce quotidien vit parfois dans un monde à part et semble Être coupÃĐ du rÃĐel.
Parce que si-face à cet article- Le Monde aurait eu la bonne idÃĐe de pondre deux grandes mÊme pages sur la "derniÃĻre journÃĐe du policier" qui a tirÃĐ sur Nahel, là , au moins, j'aurais dit : "chapeau, ça c'est du journalisme !"
C'est une tribune cet article.
Que penses tu de la thÃĐorie de ce prof?
Moi, je partage assez cette vision du troupeau qui vote RN: " du Nutella et du On est chez nous" vocifÃĐrÃĐ par les inondÃĐs du nord qui s'en prennent aux verts comme par les petits patrons du sud est ciottiste!
il va se passer une annÃĐe oÃđ l'on va bien rigoler quand vous montrerez votre vrai visage totalitaire des rÃĐgimes de gauche comme la corÃĐe du nord ou la birmanie
en imposant les choses non par vote dÃĐmocratique de l'assemblÃĐe mais mais en les imposant par dÃĐcret
vous avez virÃĐ votre cuti d'avec macron avec sa loi sur l'immigration
mais ce sera encore pire avec vos nouveaux maitres car une fois bien implantÃĐs au pouvoir il feront comme en birmanie avec les rohingyas
comment se passe l'immigration et à quel taux dans les pays qui gouvernent avec la mÊme idÃĐologie "corÃĐe du nord" "chine " " vietnam" "cuba"
leur soit disant position sur l'immigration n'est en fait qu'un miroir aux alouettes ÃĐlectoraliste et vous vous laissez avoir
normalement comme a dit une personne de l'immigration
s'ils ÃĐtaient pour "ceux issus d'une certaine immigration devraient Être plus reprÃĐsentatifs parmi leurs ÃĐlus "
je crois qu'en fait la solution anti migratoire passe par eux
si l'on regarde l'UE ; les pays les plus opposÃĐs à l'immigration sont ceux oÃđ il reste encore des relents de leur culture soviÃĻt plus de 30 ans aprÃĻs
tous les derniers pays rentrÃĐs dans l'UE qui refusent les quotats imposÃĐs
seuls les 8 pays de l'ouest sur les 27 de l'UE acceptent une rÃĐpartition d'accueil des migrants
essayez de rÃĐflÃĐchir à cela plutot que de balancer des incantations stupides incongrues pour quelqu'un qui se prÃĐtend instruit
- Fonck1
- Administrateur
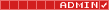
- Messages : 151299
- EnregistrÃĐ le : 02 mai 2006 16:22
- A Liké : 2 fois
- A été liké : 7 fois
Re: Pouvoir d'achat : contrairement à la perception de nombreux Français, il nâa pas baissÃĐ ces derniÃĻres annÃĐes
comparer la gauche française à la corÃĐe du nord ou la birmanie les deux sous rÃĐgime militaire, vous n'avez vraiement honte de rien.vivarais a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 09:05vos incantations ne changent rien à l'ÃĐvidenceUBUROI a ÃĐcrit : 11 juillet 2024 08:38
HS innommable!!
C'est une tribune cet article.
Que penses tu de la thÃĐorie de ce prof?
Moi, je partage assez cette vision du troupeau qui vote RN: " du Nutella et du On est chez nous" vocifÃĐrÃĐ par les inondÃĐs du nord qui s'en prennent aux verts comme par les petits patrons du sud est ciottiste!
il va se passer une annÃĐe oÃđ l'on va bien rigoler quand vous montrerez votre vrai visage totalitaire des rÃĐgimes de gauche comme la corÃĐe du nord ou la birmanie
absurde.
"Le fascisme ça commence avec les fous, ça se rÃĐalise grÃĒce aux salauds et ça continue à cause des cons."
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)
Henry de MONTHERLANT (1895-1972)