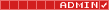Corvo a écrit : 01 novembre 2025 05:36
C'est évident.
Benjamin Stora : «Il y a en France une fraction d’“inconsolables” de l’Algérie française»
Pour l’historien, la remise en cause de l’accord de 1968 à l’Assemblée est le symptôme d’une relation franco-algérienne en crise profonde, où la mémoire continue de peser sur la diplomatie.
Pour la première fois de son histoire, le Rassemblement national a réussi à faire voter un de ses textes à l’Assemblée nationale. Adoptée jeudi à une voix près (185 pour, 184 contre), la proposition vise à dénoncer l’accord franco-algérien de 1968, qui encadre depuis plus d’un demi-siècle la circulation et le séjour des Algériens en France. Une «journée historique», s’est félicitée Marine Le Pen.
Mais cette décision, annoncée à la veille de la fête nationale algérienne et d’un votre crucial au Conseil de sécurité de l’ONU sur l’avenir du Sahara-Occidental, risque de raviver des tensions déjà vives entre Paris et Alger, met en garde l’historien Benjamin Stora.
Que signifie réellement la remise en cause de l’accord franco-algérien de 1968 ?
Concrètement, cette dénonciation change peu de choses sur le plan pratique, puisque toute décision relève toujours du pouvoir exécutif. L’accord de 1968, promulgué par le général de Gaulle à la fin des Trente Glorieuses, visait à réguler les flux migratoires et à offrir quelques avantages aux travailleurs algériens, notamment le regroupement familial.
Mais au fil des décennies, la plupart de ces dispositions avaient déjà été largement supprimées : instauration de visas en 1986, suivie d’une série de lois et décrets qui ont considérablement réduit la portée de l’accord. Le problème majeur reste que toutes ces mesures ont été décidées unilatéralement par la France, sans réelle consultation d’Alger, ce qui renforce le sentiment de vexation côté algérien. C’est ce qui s’est passé avec la loi de 2005 sur le «rôle positif de la colonisation», adoptée seule par la France sans concertation avec ses anciens pays colonisés.
Comment cette décision est-elle perçue à Alger ?
Elle ne peut être perçue que très négativement. D’autant que cette annonce intervient dans un climat déjà tendu et, qui plus est, juste avant la fête nationale algérienne, le 1er novembre, ce qui rend le timing particulièrement maladroit. Une telle décision ne facilite ni le dialogue diplomatique, ni d’éventuelles grâces présidentielles pour l’écrivain Boualem Sansal ou le journaliste Christophe Gleizes.
Depuis plusieurs années, l’Algérie revient régulièrement au centre des discours de la droite et de l’extrême droite françaises. Pourquoi ce pays est-il devenu une cible privilégiée dans le débat politique français ?
Pour une partie de la classe politique française, la perte de l’Algérie reste une blessure nationale. Contrairement au Maroc, au Sénégal ou à d’autres anciennes colonies, l’Algérie était perçue comme «la France», comme le rappelait François Mitterrand dans une allocution en novembre 1954, au début de la guerre d’indépendance. Sa séparation a été vécue comme un traumatisme historique. L’extrême droite, qui a cherché à se dédiaboliser sur la période de Vichy, n’a jamais fait son deuil de la question de l’indépendance algérienne. On peut parler d’une fraction d’«inconsolables» de l’Algérie française.
Y voyez-vous une forme «d’obsession algérienne», notamment au sein du Rassemblement national ?
Oui, d’autant que certains dirigeants actuels du parti ont des liens familiaux ou historiques avec cette période : Michèle Tabarot, née à Alicante en 1962 où se sont réfugiés des responsables de l’Organisation de l’armée secrète [OAS, un groupe clandestin qui a mené des actions terroristes entre 1961 et 1962 pour maintenir l’Algérie française, ndlr], Louis Aliot, descendant d’une famille de pieds-noirs radicalisés… Plusieurs cadres, aujourd’hui âgés d’environ 60 ans, ont accédé à des responsabilités et continuent de porter ces héritages politiques. Il s’agit certes d’une fraction du RN, mais elle est significative.
Cette décision survient à la veille d’un vote crucial du Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution portée par les Etats-Unis et soutenue par la France, visant à faire du plan d’autonomie marocain de 2007 la base d’une relance des négociations sur le conflit du Sahara-Occidental. Faut-il y voir un facteur supplémentaire de tension avec Alger, qui rejette ce plan ?
Le texte adopté pourrait permettre de trouver un compromis entre Rabat et Alger, mais il intervient effectivement dans un contexte de relations déjà très tendues. La décision française de revenir sur les accords de 1968 s’inscrit dans un ensemble de mesures conflictuelles et souligne que le chantier mémoriel demeure central : toute amélioration durable des relations franco-algériennes passera par un affrontement clair de la question de la mémoire historique.
Ces épisodes s’inscrivent-ils dans une situation inédite dans la dégradation des relations franco-algériennes ?
Jamais depuis 1962 les relations franco-algériennes n’avaient connu une telle impasse : la France n’a plus d’ambassadeur en Algérie, et l’Algérie est dans la même situation à Paris. Cette absence perdure depuis plus d’un an. Au vu des développements récents, il est difficile d’envisager un dégel à court terme. Chaque tentative d’apaisement se heurte aux dynamiques de la vie politique française, où votes et décisions viennent systématiquement raviver les tensions. L’avenir demeure donc très incertain.
https://www.liberation.fr/international ... FFXG6CC2I/