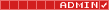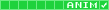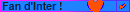Ce qui m'a poussÃĐ a m'interroger et à poser ce sujet.Petit rappel:
La RÃĐpublique, ÂŦ un idÃĐal et un combat Âŧ
Aujourdâhui, tout le monde se dit volontiers ÂŦ rÃĐpublicain Âŧ, Ã tel point que ce qualificatif, Ã tel point que le terme de ÂŦ RÃĐpublique Âŧ ne voudraient plus rien dire. Mais la RÃĐpublique nâest pas quâun mot, ni quâun simple rÃĐgime politique. La RÃĐpublique est surtout un systÃĻme de valeurs, un modÃĻle de sociÃĐtÃĐ, et comme lâa si bien dit RÃĐgis Debray, un ÂŦ idÃĐal et un combat Âŧ. Un combat incessant qui exige vÃĐritablement une foi de la part de ceux qui se disent rÃĐpublicains.
Jusquâà la Grande RÃĐvolution, ÂŦ RÃĐpublique Âŧ, qui vient du latin ÂŦ res publica (ÂŦ la chose commune Âŧ), nâÃĐtait quâun terme gÃĐnÃĐrique dÃĐsignant tout ÂŦ Etat rÃĐgi par des lois Âŧ. Ce sont les Jacobins de 1792-93 qui ont changÃĐ son sens en commençant à façonner les contours dâun ÂŦ corpus rÃĐpublicain Âŧ, oÃđ lâhÃĐritage des LumiÃĻres, oÃđ lâexigence de libertÃĐ et dâÃĐgalitÃĐ se fit sentir. Un corpus qui sâest enrichi et qui sâest ÃĐrigÃĐ en modÃĻle - la fameuse ÂŦ exception française - aprÃĻs prÃĻs de deux siÃĻcles de luttes politiques oÃđ prirent part tout autant les RÃĐvolutionnaires que les RÃĐsistants ou des hommes comme Gambetta ou JaurÃĻs.
La RÃĐpublique, lâidÃĐal rÃĐpublicain, se fonde aujourdâhui sur quelques principes fondamentaux :
LibertÃĐ, ÃĐgalitÃĐ, fraternitÃĐ, bien sÃŧr.
ÂŦ LibertÃĐ Âŧ : chacun est libre de penser et dâagir comme bon lui semble, dans la limite de ne pas nuire à autrui et de ne pas enfreindre la loi, expression de la volontÃĐ gÃĐnÃĐrale. Mais aucun homme nâÃĐtant jamais libre a priori, ça ne peut Être quâune histoire de proclamation. Il nây a pas de libertÃĐ si rÃĻgnent la loi de la jungle et lâignorance. Seules lâexistence dâun groupe, la force dâun Etat sont à mÊme de la garantir. Par le rÃĻgne absolu de la loi, qui permet à chacun la sÃŧretÃĐ physique et sociale, conditions pour vivre dignement et de sâÃĐlever selon son mÃĐrite. Mais aussi par lâinstruction obligatoire, qui entend donner à chacun une autonomie de jugement.
ÂŦ EgalitÃĐ Âŧ : tous les citoyens sont ÃĐgaux en dignitÃĐ, en chances et bien sÃŧr devant la loi, en droits comme en devoirs. Les distinctions de naissance, quâelles soient sociales, ethniques ou religieuses, ne peuvent exister. Pour que lâÃĐgalitÃĐ ne reste pas quâune affirmation de principe, lâEtat doit sâengager à permettre à ce que chacun puisse exercer effectivement ce droit (et donc celui de sâÃĐlever socialement), en complÃĐtant les droits politiques par des droits sociaux (le premier ÃĐtant le droit à lâinstruction), en redistribuant les ressources communes, en donnant plus à ceux qui ont moins. Seules les inÃĐgalitÃĐs fondÃĐes sur le mÃĐrite sont lÃĐgitimes. ÂŦ EgalitÃĐ Âŧ ne signifie pas ÂŦ identique Âŧ.
ÂŦ FraternitÃĐ Âŧ : tous les citoyens ont un devoir de solidaritÃĐ les uns envers les autres, lâintÃĐrÊt gÃĐnÃĐral, donc de tous, primant sur un ÃĐgoÃŊste chacun pour soi. La fraternitÃĐ se fonde ainsi autour d'une communautÃĐ unie par un idÃĐal, le bien commun, transcendant les diffÃĐrences et les intÃĐrÊts de chacun. En pratique, cette fraternitÃĐ est censÃĐe permettre à chacun dâaccÃĐder à une existence digne et souveraine, et ainsi de jouir pleinement de ses droits les plus ÃĐlÃĐmentaires (libertÃĐ et ÃĐgalitÃĐ, en premier lieu). Dans cette optique, lâEtat intervient dans lâÃĐconomie, sâengage dans une redistribution des richesses, et ÃĐtablit des services publics, qui mettent au service de tous ce qui lâintÃĐrÊt de tous.
Plus quâune devise, ce cÃĐlÃĻbre triptyque est surtout une philosophie cohÃĐrente, qui donne ses bases à lâidÃĐal rÃĐpublicain. Pas de libertÃĐ sans ÃĐgalitÃĐ, pas dâÃĐgalitÃĐ sans libertÃĐ, mais surtout pas de libertÃĐ et dâÃĐgalitÃĐ sans fraternitÃĐ, qui lui donne corps.