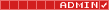à lâinstar dâautres mÃĐdias ou personnalitÃĐs, WikipÃĐdia a quittÃĐ le rÃĐseau social XâĶ le temps de quelques heures seulement. Lundi matin, un message postÃĐ par la version francophone de lâencyclopÃĐdie en ligne proclamait : ÂŦ ChÃĻre communautÃĐ, à partir dâaujourdâhui, nous arrÊtons nos publications sur X. Nous souhaitons continuer à partager la connaissance dans un climat plus serein et propice à lâÃĐchange avec vous. Âŧ Il fallait y voir une rÃĐponse aux attaques virulentes du propriÃĐtaire de X, Elon Musk, qui a appelÃĐ en dÃĐcembre au boycott de lâencyclopÃĐdie collaborative rebaptisÃĐe pour lâoccasion ÂŦ Wokepedia Âŧ, par allusion aux politiques de diversitÃĐ et dâinclusion de lâhÃĐbergeur de WikipÃĐdia, la Wikimedia Foundation.
Sauf quâen fin de journÃĐe, le message postÃĐ par WikipÃĐdia en français a ÃĐtÃĐ tout bonnement supprimÃĐ, sans plus dâexplications. En effet, la dÃĐcision prise par le community manager (un certain ÂŦ Pronoia Âŧ) a dÃĐplu à une partie des contributeurs, et certains sâen sont vivement ÃĐmus sur le ÂŦ Bistro Âŧ, lâespace numÃĐrique oÃđ ont lieu quotidiennement des discussions entre contributeurs sur lâÃĐvolution et les projets menÃĐs par WikipÃĐdia. ÂŦ Franchement, avoir utilisÃĐ une communication publique pour afficher ses idÃĐes partisanes, dans son coin, en petit comitÃĐâĶ Câest honteux et dÃĐshonorant pour tous ceux qui contribuent suivant des principes bien dÃĐfinis Âŧ, a par exemple dÃĐplorÃĐ lâun dâentre eux. Cette vive controverse, une de plus dans lâhistoire tumultueuse des ÂŦ guerres Âŧ wikipÃĐdiennes, souligne un dÃĐcalage qui va sâaccentuant entre la vaste communautÃĐ des internautes qui contribuent à lâenrichissement de WikipÃĐdia et le petit cercle de responsables bÃĐnÃĐvoles qui a la charge dâanimer cette communautÃĐ.
ÂŦLa neutralitÃĐ de point de vue est pourtant non nÃĐgociable Âŧ sur WikipÃĐdia, se dÃĐsole ; auprÃĻs du Figaro ; un important acteur du WikipÃĐdia francophone, ÂŦ mais son pÃĐrimÃĻtre est en dÃĐbat depuis presque toujours, entre ceux qui sont attachÃĐs à une neutralitÃĐ gÃĐnÃĐrale absolue, et ceux qui estiment que cela se limite au seul contenu et voient en revanche le projet WikipÃĐdia comme un mouvement politique en soi. Câest un peu une transposition, à lâÃĐchelle wikipÃĐdienne, de la divergence entre les dÃĐfenseurs de lâuniversalisme et les promoteurs du particularisme Âŧ.
ÂŦTotalement sous contrÃīle des mÃĐdias mainstreamÂŧ
Ainsi les attaques dâElon Musk ne sont-elles pas venues de nulle part. Du reste le milliardaire amÃĐricain a longtemps ÃĐtÃĐ proche des aspirations de la communautÃĐ WikipÃĐdia, celui dâun internet libre et gratuit, collaboratif, oÃđ la bonne volontÃĐ des internautes et la rationalitÃĐ collective permettent dâenrichir la connaissance et la vie pratique de tous. En 2021, il souhaitait encore un joyeux anniversaire à WikipÃĐdia, qui soufflait alors sa vingtiÃĻme bougie, en commentant : ÂŦ Je suis tellement content que tu existes. Âŧ Et pour cause, il poste rÃĐguliÃĻrement des contenus issus de lâencyclopÃĐdie en ligne quâil juge enrichissants pour sa culture gÃĐnÃĐrale.
Mais Elon Musk a rÃĐcemment compris les biais qui affectent certains contenus sur WikipÃĐdia. à la fin de 2022, alors quâil vient de racheter Twitter (devenu X), il suspend les comptes dâune dizaine de journalistes qui enquÊtaient sur lui et sa dÃĐcision suscite un ÃĐcho important sur WikipÃĐdia, qui consacre à cet ÃĐvÃĐnement une page trÃĻs fournie, vraisemblablement alimentÃĐe par ses adversaires. Câest le risque de laisser un espace de production de savoir à la portÃĐe de tout le monde : il suffit dâun peu de temps libre devant soi pour en faire un outil militant, destinÃĐ Ã servir une cause ou nuire à une autre. Un peu de temps libreâĶ et des sources qui lÃĐgitiment le propos : en effet sur WikipÃĐdia, les faits et les informations rapportÃĐs doivent Être corroborÃĐs par des sources jugÃĐes fiables et objectives. Câest transfÃĐrer aux mÃĐdias la responsabilitÃĐ de filtrer, selon lâattention ÃĐditoriale consacrÃĐe aux diffÃĐrents sujets, ce qui est suffisamment digne dâintÃĐrÊt pour Être relevÃĐâĶ Le milliardaire sâÃĐcrie alors (sur X, ÃĐvidemment) : ÂŦ WikipÃĐdia est totalement sous contrÃīle des mÃĐdias mainstream. Âŧ
à compter de là , les attaques dâElon Musk contre lâencyclopÃĐdie en ligne se multiplient, dâabord sous forme de trolling quand il promet en 2023 de verser 1 milliard de dollars à la Wikimedia Foundation si celle-ci consent à rebaptiser son site internet ÂŦ Dickipedia Âŧ, puis en 2024 sous forme dâappel au boycott, lorsque Elon Musk encourage les internautes à ne plus donner à la Wikimedia Foundation.
ÂŦLa majoritÃĐ des contributeurs sont de gaucheÂŧ
Cette guerre Musk vs WikipÃĐdia met en lumiÃĻre plusieurs biais qui peuvent en effet jeter le discrÃĐdit sur une partie du contenu de lâencyclopÃĐdie. Le premier et le plus ÃĐvident est la relative homogÃĐnÃĐitÃĐ socioculturelle de ses contributeurs. Le sujet est pourtant presque tabou au sein de la communautÃĐ, et quiconque y fait allusion dans les espaces de discussion suscite en retour une dÃĐsapprobation gÃĐnÃĐrale. Pourtant, la rÃĐalitÃĐ est que les contributeurs principaux sont pour lâessentiel des jeunes, lycÃĐens ou ÃĐtudiants faisant de hautes ÃĐtudes, ou bien actifs appartenant aux CSP+. En 2011 WikimÃĐdia France, un chapitre affiliÃĐ Ã la Wikimedia Foundation chargÃĐ de promouvoir la version francophone de WikipÃĐdia, lâavait dâailleurs montrÃĐ dans une enquÊte statistique. Ces contributeurs sont encore à majoritÃĐ des hommes, et des urbains. DÃĻs lors, et sans surprise quand on sait lâengouement quâa suscitÃĐ Ã ses dÃĐbuts le projet au sein des courants libertaires de la gauche progressiste, lâorientation politique majoritaire des contributeurs rÃĐguliers de WikipÃĐdia fait peu de doute. ÂŦ La majoritÃĐ des contributeurs sont de gauche, câest une ÃĐvidence de le dire Âŧ soutient au Figaro une wikipÃĐdienne trÃĻs proche des administrateurs actuels de WikimÃĐdia France.
La composition de cette communautÃĐ et sa reprÃĐsentativitÃĐ ou non de lâensemble de la sociÃĐtÃĐ ne sont pas sans incidence sur le contenu de WikipÃĐdia, car dÃĻs quâun dÃĐsaccord survient, câest aux contributeurs les plus importants de trancher, sous forme de discussions argumentÃĐes puis, parfois, de votes. Ainsi les contributeurs de WikipÃĐdia sâaccordent entre eux sur la qualitÃĐ et la valeur des sources journalistiques, et dÃĐbattent rÃĐguliÃĻrement du crÃĐdit quâil faut accorder à certains journaux. Ceux dont les lignes ÃĐditoriales les classent à droite font lâobjet dâun traitement systÃĐmatiquement plus mÃĐfiant. Ainsi la question de la pertinence dâutiliser un article du Figaro comme source a ÃĐtÃĐ plusieurs fois discutÃĐe, et plus souvent encore pour les textes publiÃĐs dans les pages dÃĐbats et opinions de notre journal, quand la question nâa en revanche jamais ÃĐtÃĐ posÃĐe pour Le Monde, ni mÊme LibÃĐration.
Un autre exemple : si Valeurs actuelles est considÃĐrÃĐ comme ÂŦ dâextrÊme droite Âŧ et CNEWS ÂŦ peu fiable Âŧ, le mÃĐdia en ligne ArrÊts sur images, malgrÃĐ ses prises de position ÃĐditoriales trÃĻs proches des idÃĐes du sillage intellectuel de La France insoumise, est un simple ÂŦ site web français dâanalyse et de critique des mÃĐdias Âŧ, dont la fiabilitÃĐ est au-dessus de tout soupçon.
Si Valeurs actuelles est considÃĐrÃĐ comme ÂŦ dâextrÊme droite Âŧ et CNEWS ÂŦ peu fiable Âŧ, le mÃĐdia en ligne ArrÊts sur images est un simple ÂŦ site web français dâanalyse et de critique des mÃĐdias Âŧ
Câest cette distorsion dans la prise en compte des sources journalistiques qui explique aussi que, dans les fiches WikipÃĐdia consacrÃĐes à des sujets ou des personnalitÃĐs au cÅur des clivages politiques contemporains, on peut observer des disparitÃĐs de traitement flagrantes. Les exemples sont presque infinis : pour sâen convaincre, prenons deux personnalitÃĐs connues sur YouTube pour leurs vidÃĐos engagÃĐes, Julien Rochedy (ancien militant et candidat FN) et Usul (ancien de la Ligue communiste rÃĐvolutionnaire, militant et candidat au sein de LFI). En principe, lâun est le miroir de lâautre, de chaque cÃītÃĐ du spectre politique : ce sont deux hommes ayant une forte notoriÃĐtÃĐ sur les rÃĐseaux sociaux, qui distillent leurs convictions dans leurs vidÃĐos aprÃĻs avoir longtemps choisi de militer au sein de partis antisystÃĻme. Pourtant, sur WikipÃĐdia, Julien Rochedy est ÂŦ un homme politique français dâextrÊme droite Âŧ quand Usul est un simple ÂŦ vidÃĐaste web et chroniqueur français ÂŧâĶ son engagement à gauche nâÃĐtant mentionnÃĐ que bien plus tard dans sa fiche.
Une fuite en avant dans les politiques de diversitÃĐ et dâinclusion
Des collectifs militants ont du reste bien compris la faille. Et sây engouffrent allÃĻgrement en organisant mÊme des formations pour influencer le contenu de certaines pages de WikipÃĐdia, comme lâa montrÃĐ dans Le Point la journaliste Nora Bussigny en participant à lâune des formations organisÃĐes par le collectif antisioniste Urgence Palestine.
Mais outre la polarisation de ses contributeurs, WikipÃĐdia pÃĒtit dÃĐsormais depuis plusieurs annÃĐes de la politisation des fondations Wikimedia. Aux Ãtats-Unis lâancienne directrice gÃĐnÃĐrale de la Wikimedia Foundation, Katerine Maher, a rÃĐvÃĐlÃĐ son adhÃĐsion aux thÃĐories woke en attaquant violemment le caractÃĻre ÂŦ libre et ouvert Âŧ de lâencyclopÃĐdie, affirmant que celui-ci maquille en rÃĐalitÃĐ ÂŦ une construction occidentalisÃĐe dâhommes blancs Âŧ visant à ÂŦ lâexclusion de certaines communautÃĐs et certaines langues Âŧ. Sur ses 170 millions de budget, alimentÃĐ en majeure partie par les dons des internautes visÃĐs par des campagnes publicitaires appelant à faire progresser la connaissance sur internet, la Wikimedia Foundation a dÃĐpensÃĐ plus de 30 millions dans des politiques de diversitÃĐ et dâinclusion.
Du cÃītÃĐ de WikimÃĐdia France, dont Le Figaro a dÃĐjà narrÃĐ les orientations idÃĐologiques, des liens troubles existent depuis plusieurs annÃĐes entre des membres du conseil dâadministration et lâassociation ÂŦ les sans pagEs Âŧ qui rÃĐmunÃĻre des salariÃĐs pour produire du contenu WikipÃĐdia sur des personnes appartenant à des groupes identifiÃĐs comme minoritaires et sous-reprÃĐsentÃĐs sur lâencyclopÃĐdie. Un dÃĐcalage grandissant est apparu entre le camp des ÂŦ sans pagEs Âŧ et le reste de la communautÃĐ WikipÃĐdia, par exemple à lâoccasion dâun vote par lequel des membres de cette association (subventionnÃĐe par WikimÃĐdia France) ont tentÃĐ dâinterdire sur WikipÃĐdia lâusage du ÂŦ dead name Âŧ, le nom par lequel on dÃĐsignait une personne trans avant quâelle ne change de genre. La prÃĐsidente des ÂŦ sans pagEs Âŧ Anne-Laure Michel avait alors incitÃĐ la communautÃĐ LGBT, sur un serveur de discussion Mastodon, à participer massivement au vote : un ÂŦ rameutage Âŧ explicitement rÃĐprouvÃĐ dans la communautÃĐ WikipÃĐdia. Une technique qui permet certes de remporter des batailles idÃĐologiques, mais que WikimÃĐdia France nâaurait pas dÃŧ cautionner, juge un contributeur proche des hautes instances de la fondation.
Samedi 25 janvier, lors du prochain conseil dâadministration de WikimÃĐdia France, les administrateurs devront en tout cas dÃĐfinir une stratÃĐgie à adopter vis-à -vis de ces doutes persistants sur la neutralitÃĐ de lâencyclopÃĐdie dont ils ont la garde. Lâissue laisse peu de doutes : au cours dâun atelier spÃĐcifiquement animÃĐ Ã cet effet, les administrateurs vont surtout dÃĐbattre de lâopportunitÃĐ pour WikimÃĐdia France de quitter ÃĐgalement le rÃĐseau social X. SollicitÃĐs par Le Figaro, le prÃĐsident, Antoine Srun, et le directeur gÃĐnÃĐral de WikimÃĐdia France, RÃĐmy Gerbet, nâont pas souhaitÃĐ rÃĐpondre à nos demandes dâentretien. ÂŦ Warning Âŧ, a aussitÃīt ÃĐcrit ce dernier sur une boucle de messagerie interne immÃĐdiatement aprÃĻs notre sollicitation : ÂŦ On ne rÃĐpond pas Âŧ, a-t-il ordonnÃĐ Ã ses ÃĐquipes. Quant à la Wikimedia Foundation, qui hÃĐberge la majeure partie du contenu de lâencyclopÃĐdie sur des serveurs amÃĐricains, elle envisage dÃĐsormais de dÃĐmÃĐnager lâhÃĐbergement de WikipÃĐdia ailleurs quâaux Ãtats-Unis pour ÃĐchapper à dâÃĐventuelles lÃĐgislations à venir qui contreviendraient à ses politiques woke.